Là où l’intelligence artificielle nous a déjà dépassés
Substack di Stefano Feltri, http://www.settimananews.it 14.03.2025 Stefano Feltri Traduit par: Jpic-jp.orgCes derniers mois, certaines décisions politiques ont provoqué une série de turbulences sur les marchés financiers : les droits de douane imposés par Donald Trump ont fait chuter les actions aux États-Unis comme en Europe ; les émissions obligataires destinées à financer les dépenses militaires dans des pays majeurs comme l’Allemagne ont fait grimper les taux des obligations d’État, faisant ainsi baisser leurs prix. Une seule force tire dans la direction opposée : l’essor de l’intelligence artificielle. Cet article a été publié en mars, avant que le nouveau pape élu ne choisisse le nom de Léon, voyant dans l’IA l’aube d’une nouvelle révolution.
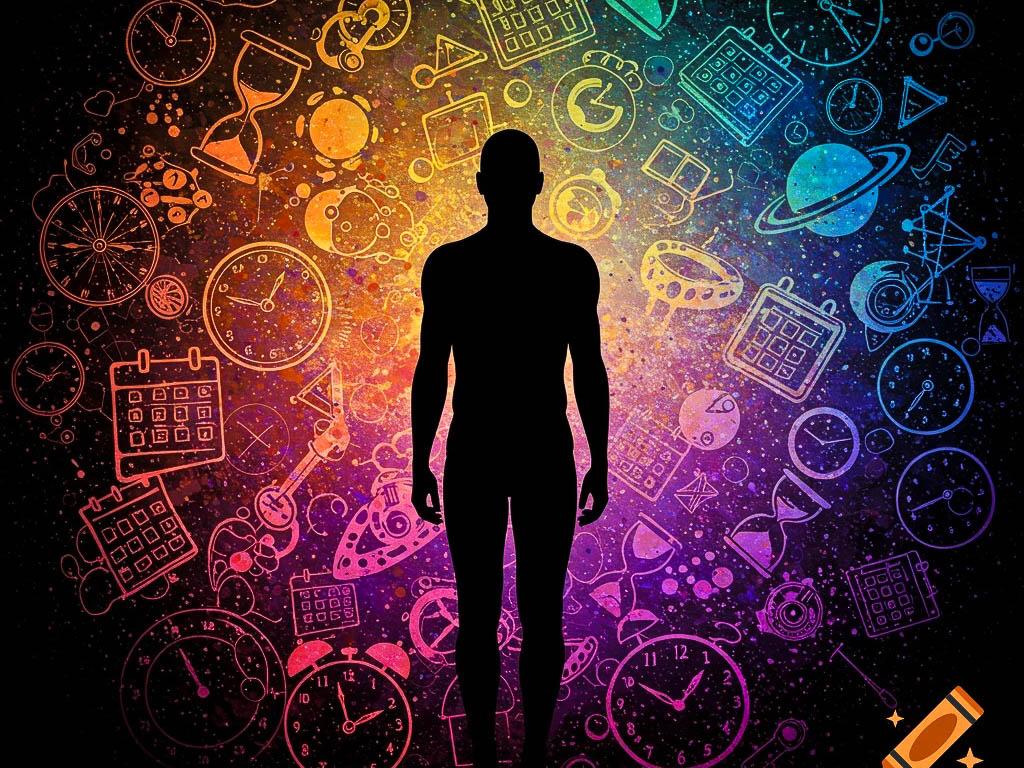
Au-delà de la géopolitique, le facteur le plus décisif pour expliquer le comportement des marchés boursiers au cours des deux ou trois dernières années réside dans les paris des investisseurs sur le potentiel de l’intelligence artificielle, sur la vitesse de sa diffusion et, par conséquent, sur les perspectives de profit des entreprises qui proposent des services fondés sur l’IA ou vendent les puces nécessaires à l’entraînement de ces algorithmes.
Mais notre obsession pour le court terme nous a fait perdre de vue une question plus large : tandis qu’OpenAI, Elon Musk, Anthropic et DeepSeek poursuivent le développement d’une intelligence générale artificielle (AGI) censée ressembler à l’esprit humain, les machines nous ont déjà surpassés dans de nombreuses tâches spécifiques.
Encore en 2016, il avait fait sensation dans le monde entier qu’une IA, AlphaGo, ait battu le champion humain Lee Sedol au jeu de go – un équivalent asiatique des échecs. Aujourd’hui, il serait impossible pour un humain de gagner, tant l’algorithme a continué à évoluer.
Nello Cristianini, professeur d’intelligence artificielle à l’Université de Bath et collaborateur de Appunti, a retracé dans ses ouvrages La Scorciatoia et Macchina Sapiens (tous deux parus chez Il Mulino) l’ascension de cette nouvelle génération d’IA. Il publie aujourd’hui Sovrumano. Oltre i limiti della nostra intelligenza (Il Mulino). Entretien.
Dans quels domaines l’intelligence artificielle a-t-elle déjà dépassé les capacités humaines ? Et comment évolue-t-elle ?
L’être humain se considère capable de résoudre une grande variété de problèmes : de la traduction du latin au diagnostic médical, voire à l’invention de nouveaux médicaments. Une même intelligence peut s’appliquer à des tâches très diverses : c’est ce que l’on appelle aujourd’hui « intelligence générale artificielle ».
Deux grandes approches sont actuellement explorées pour parvenir à cette AGI hypothétique. La première est appelée l’hypothèse de l’échelle (scaling hypothesis) : l’idée selon laquelle augmenter la taille des modèles actuels améliorerait leur intelligence générale. Cette hypothèse est très soutenue, de grandes entreprises y investissent des milliards de dollars, convaincues qu’en augmentant la taille des modèles — sans en modifier l’architecture — on pourra obtenir des résultats importants.
La seconde approche, plus récente, concerne le raisonnement : la capacité de la machine à produire des raisonnements logiques authentiques. Les deux voies pourraient s’avérer efficaces, peut-être même complémentaires. Ce n’est pas une question d’opinion ou de spéculation, mais d’ingénierie.
Comment peut-on savoir si une machine est plus intelligente que nous ?
Si nous voulons construire des machines de plus en plus intelligentes, il faut pouvoir mesurer leurs progrès. Si notre objectif est d’atteindre un certain niveau de compétence humaine, nous devons pouvoir déterminer à quel moment ce niveau est atteint.
Il existe en effet une science de la mesure de l’intelligence des machines — une sorte de « psychométrie des machines », où l’on soumet les systèmes d’IA à des batteries de tests sophistiqués, en mesurant leurs performances.
À chaque génération, les machines progressent. On peut soumettre les mêmes tests aux humains afin d’observer à quel moment les machines égalent ou dépassent leurs performances. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des mesures objectives et reproductibles.
Les entreprises se livrent à une concurrence active dans ce domaine, les tests deviennent de plus en plus complexes, et les machines, de plus en plus capables : elles se rapprochent du niveau humain. On ne peut plus faire semblant de ne pas le voir.
Où en est-on aujourd’hui ?
Les grandes entreprises technologiques ont déjà esquissé une sorte de feuille de route vers l’intelligence générale artificielle. OpenAI, créateur de GPT, prévoit cinq étapes :
- Les Conversationnels : machines capables d’interagir par le langage (où nous en sommes aujourd’hui et depuis quelques années) ;
- Les Raisonneurs : systèmes capables de raisonnement logique (déjà en cours de développement sous des formes performantes) ;
- Les Agents : machines capables d’agir de manière autonome sur Internet, de chercher des informations, de s’abonner à des services, de payer des factures, le tout pour atteindre un objectif ;
- Les Innovateurs : systèmes capables de création ou d’innovation véritable ;
- Les Organisations : réseaux d’agents collaborant à des objectifs complexes.
Nous en sommes actuellement à la troisième phase : celle des « agents ».
Quelles sont les conséquences du fait que l’IA soit déjà « surhumaine » dans certains domaines ?
Il faut reconnaître qu’en certains domaines, nous avons déjà été dépassés, et que dans d’autres, cela pourrait arriver très vite. C’est sur cette base que nous devons bâtir notre réflexion.
Au-delà des cas spécifiques où les machines nous surpassent (comme aux échecs), les IA généralistes – telles que GPT-4 ou Claude 3.7 – obtiennent de meilleurs résultats dans divers domaines quand elles sont soumises à des tests rigoureux.
Par exemple, dans les récents tests en mathématiques et en programmation, elles surpassent souvent l’humain moyen, et parfois même les individus très compétents. Dans certains cas, elles dépassent le niveau des meilleurs spécialistes, avec au moins 10 % d’avantage sur la population générale, un écart désormais bien documenté. Elles réussissent des examens universitaires, posent des diagnostics médicaux, traduisent couramment dans près de 200 langues. Dans de nombreux domaines, elles égalent nos capacités, rivalisent avec elles ou les dépassent.
Les effets concrets sont déjà visibles. Le secteur de la traduction a été parmi les premiers touchés : jusqu’il y a peu, un traducteur spécialisé dans des langues rares (comme le lituanien ou le portugais) pouvait très bien gagner sa vie. Aujourd’hui, n’importe quelle combinaison parmi 200 langues est prise en charge sans effort — et gratuitement — par des machines.
Les radiologues pourraient être les prochains — les IA interprètent déjà certaines images mieux que les humains — tout comme les chauffeurs de taxi, les journalistes, les enseignants, ou même les médecins.
C’est un monde en évolution rapide, et nous devons nous y préparer. Il faudra aussi rendre l’IA plus durable sur le plan environnemental, avec des coûts énergétiques réduits et davantage de conformité réglementaire.
À l’avenir, il faudra également dépasser notre dépendance actuelle aux textes : pour l’instant, les machines lisent principalement le web sous forme textuelle, mais elles devront progressivement générer leurs propres données depuis le monde réel — via des robots ou des véhicules — et à ce moment-là, nous ne pourrons plus « voir » tout ce qu’elles apprennent. La recherche est loin d’être terminée.
Dans le monde du travail, ce sentiment d’être dépassé que les traducteurs éprouvent aujourd’hui — en voyant que les machines font désormais leur travail plus efficacement — pourrait bientôt être partagé par les radiologues, ingénieurs logiciels, médecins, enseignants, journalistes, dans divers contextes.
Quel rôle reste-t-il à l’être humain ?
Cette question m’intéresse autant sur le plan philosophique que pratique. Philosophique, car c’est le moment de s’arrêter et de réfléchir : il faut identifier ce que les machines ne pourront jamais faire. Je l’appelle, non sans humour, le « résidu » : ce qui reste une fois que la machine a pris tout ce qu’elle peut. Ce résidu, c’est ce qui est proprement humain. Et cela fonctionne aussi dans l’autre sens : il y a des choses que la machine peut faire, et nous pas, c’est aussi un type de résidu.
Nous allons découvrir ces territoires à mesure qu’ils nous deviennent inaccessibles, car la machine avancera de plus en plus loin, jusqu’à franchir une frontière et entrer dans un monde qui nous sera incompréhensible. Mais de notre côté aussi, il existe des choses que nous pouvons faire et que la machine ne pourra jamais faire.
Identifions-les maintenant, car c’est là que se trouve notre identité, notre emploi, notre avantage compétitif. Je ne dis pas que répondre à cette question humaniste sera facile, mais il faut s’y atteler dès maintenant. Ne commettons pas l’erreur de la balayer d’un revers de main avec ce vieux récit selon lequel nous serions « imbattables » pour une raison vague, inexpliquée. Si nous connaissons cette raison, expliquons-la, car les données, elles, racontent une tout autre histoire.
Vivons-nous une nouvelle révolution industrielle ?
Il y a eu dans l’histoire des moments comparables, où une innovation technologique majeure — comme la machine à vapeur — a tout changé. Il est vrai que l’arrivée de la machine à vapeur fut une rupture, mais les sociétés s’y sont adaptées. On pourrait penser qu’il en sera de même aujourd’hui.
Mais rappelons-nous que la machine à vapeur a eu des conséquences profondes : elle a lancé un certain type d’industrie, a concentré la main-d’œuvre dans les villes, fait migrer les populations rurales vers les centres urbains, créé un prolétariat jusque-là inexistant, donnant naissance au socialisme, aux révolutions. Une innovation technique a changé le cours de l’histoire. Cela pourrait bien se reproduire.
C’est ce type d’innovation qui peut transformer le monde. Il faut comprendre que « surhumain » peut sembler dramatique, mais cela signifie simplement « au-delà des limites humaines ». Ce n’est ni surnaturel, ni magique : une machine surhumaine est simplement une machine plus performante que moi.
S’agissant de l’intelligence, cela signifie une machine plus intelligente qu’un être humain et nous devons aborder cela avec le calme des scientifiques : comment elle est mesurée, comment elle est détectée, comment elle est conçue, contrôlée et contenue.
Voilà, selon moi, la mission des chercheurs en 2025.












 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire