Heureux les pauvres, mais non la misère
Avvenire 11.10.2025 Luigino Bruni Traduit par: Jpic-jp.orgPour le monde, même pour sa meilleure part, la pauvreté n’est qu’un mal à éradiquer. Et c’est vraiment trop peu. ‘Dilexi te’, le premier document du pape Léon XIV inspiré par le pape François, parle surtout de la mauvaise pauvreté, c’est-à-dire de la misère et de la privation, mais il n’oublie pas la belle pauvreté de l’Évangile. Il n’y aura pas d’éthique dans l’économie sans redonner sa juste valeur à la pauvreté évangélique et à l’usage social de la richesse.

Dans l’humanisme chrétien, le spectre du mot « pauvreté » est très large. Il va du désespoir de ceux qui subissent la pauvreté par la faute des autres ou des malheurs, à ceux qui choisissent librement la pauvreté comme chemin de béatitude, un choix libre qui devient souvent la voie royale pour libérer ceux qui ne l’ont pas choisie. Dans l’Église, il y a toujours eu, et il y a encore, des milliers de femmes et d’hommes qui se sont faits pauvres pour espérer entendre le mot « bienheureux » (Dilexi te, DT, n. 21), et qui ont ensuite compris que cette première béatitude de Jésus, ils ne pouvaient l’écouter qu’en devenant compagnons de ceux qui ne connaissent de la pauvreté que sa face sombre.
Ainsi, si cette pauvreté choisie — cet avant-goût du Royaume des cieux — venait à disparaître de la terre au nom d’un « objectif du millénaire » atteint (n. 10), ce jour-là apporterait une bien mauvaise nouvelle à l’humanité, qui, sans la pauvreté évangélique, se retrouverait infiniment plus pauvre et misérable, sans même s’en rendre compte.
La Dilexi te (DT) du pape Léon XIV parle surtout de la pauvreté mauvaise — qu’on pourrait aussi appeler misère ou privation — afin de nous pousser à en prendre soin et à ne pas « baisser la garde » (n. 12). Mais elle n’oublie pas la belle pauvreté de l’Évangile, surtout dans les longues sections consacrées à la vision biblique de la pauvreté.
D’après les Évangiles et la vie, nous savons qu’il est impossible de séparer le regard et le jugement évangéliques sur la pauvreté de ceux portés sur la richesse (n. 11). En effet, la pauvreté n’est pas un statut individuel, un trait de personnalité, ni « un destin amer » (n. 14). C’est une relation faussée avec les personnes, les institutions et les biens ; c’est un mal relationnel, le résultat de choix collectifs et individuels, de personnes et d’institutions concrètes.
S’il existe des personnes qui se retrouvent, sans l’avoir choisi, dans une condition de misère, c’est profondément lié à d’autres personnes et institutions qui possèdent des richesses excessives et souvent injustes, et qui, presque toujours, l’ont voulu. Il ne s’agit pas de dire que ta richesse est la cause de ma pauvreté — thèse qui nourrit bien des jalousies sociales —, mais de reconnaître simplement la nature fondamentalement relationnelle (n. 64), sociale et politique des pauvretés et des richesses humaines, surtout chez les femmes (n. 12), les filles et les enfants.
Voilà pourquoi il n’est pas simple pour l’Église de parler de la pauvreté et des pauvres : il faut maintenir en tension vivante ces deux dimensions de la pauvreté — la bonne et la mauvaise —, car si l’on en oublie une, on commet plus qu’une erreur : on sort de l’Évangile.
Le discours devient encore plus difficile lorsque l’on pousse jusqu’au bout la logique paradoxale des Béatitudes et que l’on découvre qu’au nombre des pauvres appelés « bienheureux » par Jésus, il n’y a pas seulement les pauvres à la manière de François d’Assise, qui ont choisi la pauvreté, mais aussi les pauvres comme Job, ceux qui l’ont subie. Et là, se trouve la difficulté : « bienheureux » les uns et les autres, sans honte, ce qui permet de dire
« Heureux les pauvres », béatitude aussi des enfants et des mourants.
La Dilexi te est à la fois un appel à l’action des chrétiens et une méditation sur la pauvreté vue à la lumière de l’Ancien et du Nouveau Testament, de Paul, des Pères, de la tradition de l’Église, avec une attention particulière à ses charismes qui ont placé les pauvres et la pauvreté au centre : François d’Assise (n. 64) et ses nombreux amis. C’est aussi une réflexion sur la pauvreté propre à Jésus lui-même (nn. 20-22).
Il est important que cette première exhortation du pape Léon soit en pleine continuité — y compris dans le titre, jumeau de Dilexit nos — avec le magistère du pape François sur la pauvreté (n. 3), thème central de son pontificat.
Le pape François a choisi le lieu de Lazare (Lc 16), sous la table du riche Épulon, comme poste d’observation sur le monde. De là, il a vu des personnes et des choses différentes — parmi elles, les prisons (n. 62) — de celles qu’aperçoivent ceux qui regardent le monde assis aux côtés du riche.
Avec Dilexi te, Léon nous dit qu’il veut continuer à regarder l’Église et le monde avec François et avec les Lazares de l’histoire. Et c’est vraiment une belle nouvelle.
Les pauvres, écrit-il, « ne sont pas là par hasard ni par un destin aveugle et amer » (n. 14), et pourtant, ajoute-t-il, « il y a encore quelqu’un qui ose l’affirmer, montrant ainsi cécité et cruauté ».
Il est important que le pape Léon relie, ici encore dans la continuité de François, cette « cécité et cruauté » à la « fausse vision de la méritocratie », car il s’agit d’une idéologie où « il semble que seuls ceux qui ont réussi dans la vie méritent quelque chose » (n. 14).
Ainsi, la méritocratie est une fausse vision. L’idéologie méritocratique est en effet l’une des principales « structures de péché » (nn. 90 ss.) qui engendrent l’exclusion et tentent ensuite de la légitimer éthiquement.
Une dernière note. Il existe aujourd’hui un grand magistère laïc sur la pauvreté non choisie. C’est celui de A. Sen, M. Yunus, Esther Duflo (trois prix Nobel) et de nombreux autres chercheurs qui nous ont appris beaucoup de choses nouvelles sur les pauvretés. Ils nous ont montré que la pauvreté est une privation de liberté, de capacités (capabilities), donc une absence de capitaux (sociaux, sanitaires, familiaux, éducatifs…) qui nous « empêchent de vivre la vie que nous désirons mener » (A. Sen).
Le manque de capitaux se manifeste comme manque de flux (revenus), mais ce n’est qu’en soignant les capitaux qu’on pourra améliorer les flux demain. Et ce sont vers ces capitaux que devraient aussi s’orienter « les aumônes » (nn. 115 ss.), comme le font depuis des siècles les nombreux charismes de l’Église (nn. 76 ss.), en combattant la misère « en capital », en construisant des écoles ou des hôpitaux.
Nous espérons que de futurs documents pontificaux incluront ce magistère laïc sur la pauvreté, désormais essentiel pour la comprendre et la soigner. Et nous espérons aussi que le monde laïc découvrira la beauté de la pauvreté choisie.
Car pour le monde, même pour sa meilleure part, la pauvreté n’est qu’un mal à éradiquer. Et c’est vraiment trop peu.
Voir, Luigino Bruni: Beati i poveri, non la miseria








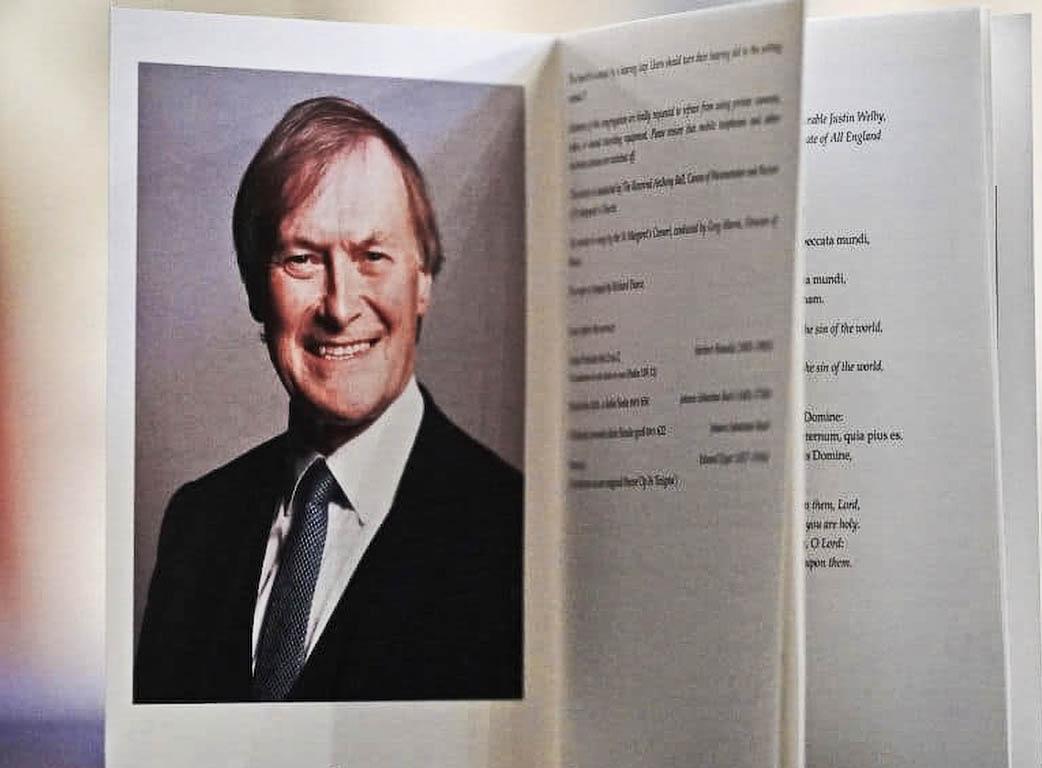
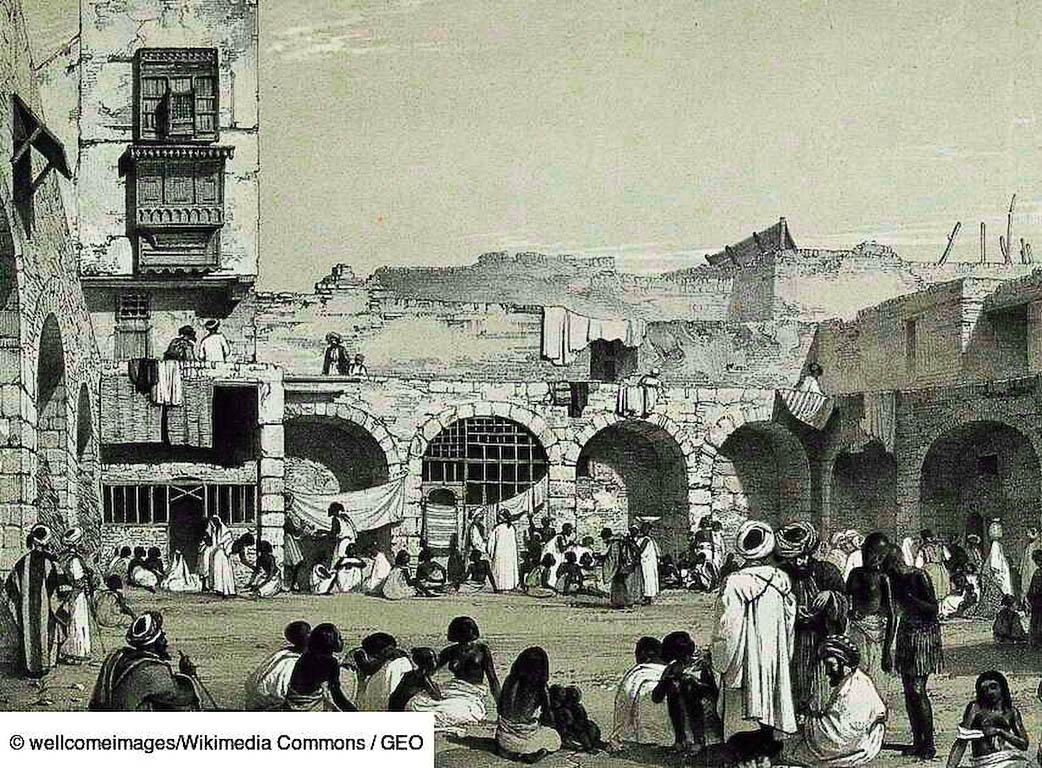











 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire