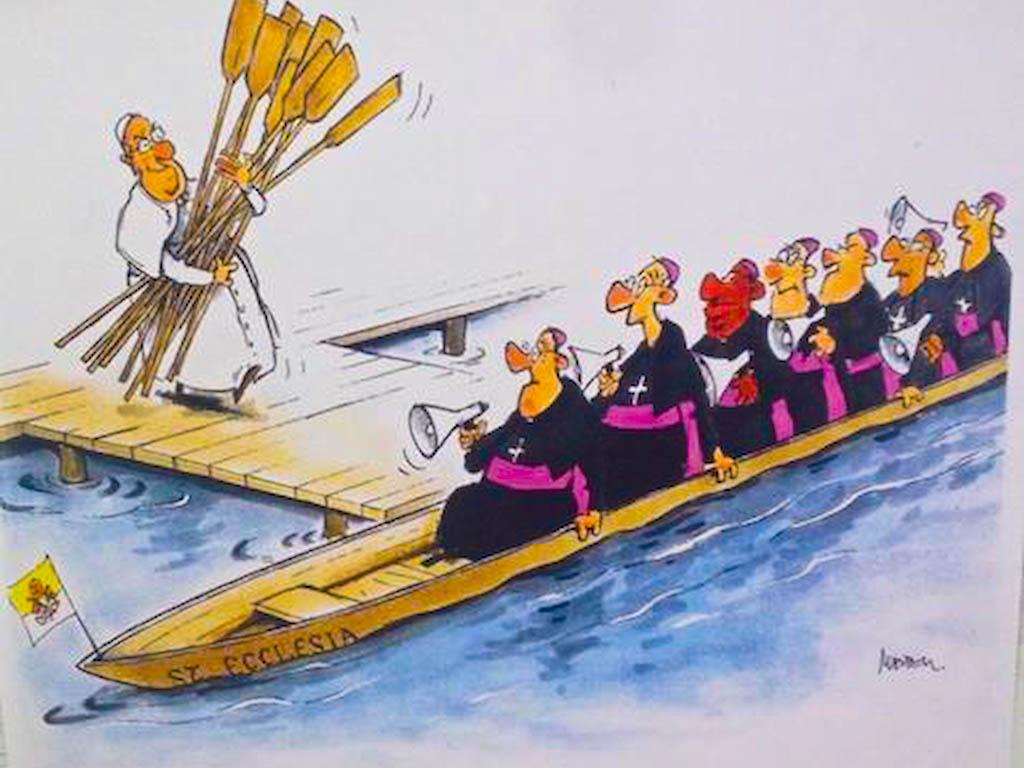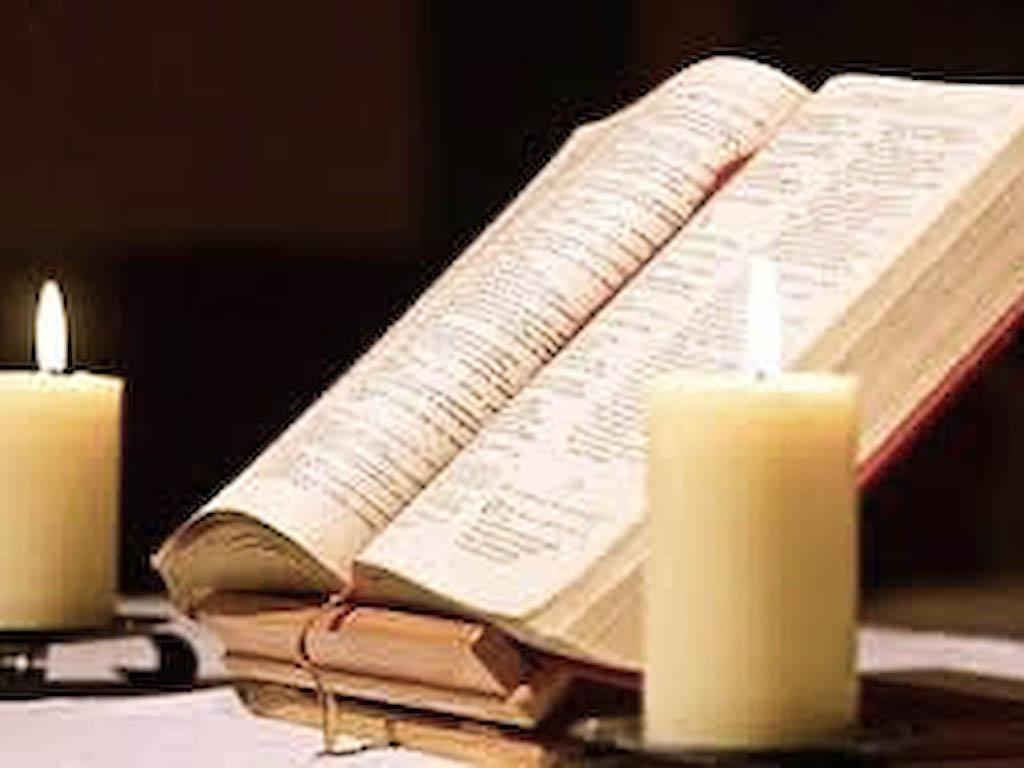Jpic Nouvelles du Blog de Jean Paul ? Vol. 12 - No 07
|
A LA ÙNE
Guerre sainte, paix profaneLa guerre et la politique sont des réalités profanes, séculières, tout comme la démocratie, la liberté et les droits, qui se réalisent (si, où et quand) sous des formes toujours partielles et contradictoires. L'Église de Jésus ne répond pas à l'idolâtrie en sacralisant ce qui semble politiquement souhaitable, mais plutôt en reconnaissant la relativité de tout ce qui est terrestre. Cela ne signifie pas que la démocratie, la liberté et les droits ne sont pas des réalités importantes qui méritent d'être toujours recherchées. Seulement que, comme le dit le pape François, la paix est toujours bien meilleure que la guerre. Il y a quelques semaines, alors que les églises catholique et évangélique célébraient la semaine sainte, le patriarche Kirill a lui aussi déclaré « sainte » la guerre de Poutine. Rien de nouveau sur le fond, ni au regard de l'histoire : de larges secteurs de la chrétienté, par exemple, ont fait et dit quelque chose de semblable dans d'autres circonstances. Il s'agit bien sûr d'un langage coloré. Le Conseil œcuménique des Églises a demandé des éclaircissements : qui sait, peut-être que tôt ou tard, Kirill, pour mieux s'expliquer, quittera le Conseil de son propre chef. Conseil mis à part, comment les autres Églises peuvent-elles réagir à de telles tonalités ? Au moins sur un point, à mon avis non négligeable, on peut être d'accord : pas d'attitude symétrique, pas de guerre sainte pour la démocratie, pour la liberté, pour les droits. La guerre, et la politique aussi, sont des réalités profanes, séculières ; de même que la démocratie, la liberté et les droits, réalisés (si, où et quand ils le sont), sous des formes toujours partielles et contradictoires. L'Église de Jésus ne répond pas à l'idolâtrie en sacralisant ce qui semble politiquement souhaitable, mais plutôt en reconnaissant la relativité de tout ce qui est terrestre. Cela ne signifie pas que la démocratie, la liberté et les droits ne sont pas des réalités importantes qui valent la peine d'être recherchées, toujours. Seulement que, comme le dit le pape François (ainsi d'ailleurs que tous les autres habitants de la planète, y compris, je suppose, Poutine et Kirill), la paix vaut beaucoup mieux que la guerre. Continuer la lecture | |
|
LA BONNE NOUVELLE
L'évangélisation de l'écologieLa prise de conscience de la destination universelle des biens, du bien commun, du développement intégral, durable et inclusif est une bonne nouvelle. Et aussi qu'il existe un « péché écologique », articulé en trois relations : contre la création, contre les personnes et contre Dieu. Un tel péché doit être pris au sérieux et signalé dans la formation de la conscience chrétienne, dans la catéchèse, dans les formulaires d'examen de conscience. L'évangélisation de l'écologie doit aider, à la lumière de l'évangile de la création et de la rédemption, c'est-à-dire à la lumière d'une perspective religieuse, à comprendre que la question écologique est une question intégrale : elle concerne non seulement les aspects économiques, techniques, biologiques, mais aussi les aspects anthropologiques, éthiques, spirituels, culturels. Par conséquent, sa solution dépendra d'une approche non seulement phénoménologique, économique, technique, biologique, climatique, mais aussi d'un changement culturel, du cœur, de la part de la personne et des peuples. Elle dépendra de l'acquisition du premier principe écologique, qui est celui de l'écologie intégrale - un concept spécifique, fruit d'une approche chrétienne -, d'une anthropologie théocentrique, d'une conversion morale. La religion de l'ego, selon laquelle l'homme est dieu, conduit inévitablement à une anthropologie déviante, à un usage inconsidéré de la création, des nouvelles technologies, en les absolutisant. La création n'est pas au service de la technique, mais ce doit être l'inverse. Continuer la lecture | |
|
LA MAUVAISE NOUVELLE
Les dépenses militaires dans le monde continuent d'augmenterLe dernier rapport du SIPRI estime à 6,8 % l'augmentation due aux tensions mondiales et aux conflits armés. Les dépenses militaires dans le monde continuent d'augmenter, atteignant un record historique de 2 443 milliards de dollars en 2023. Cette croissance de 6,8 % d'une année sur l'autre est la conséquence directe de l'implication croissante, directe ou indirecte, des grandes puissances militaires. Les estimations de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), rapportées par le Réseau italien pour la paix et le désarmement, montrent que l'humanité s'approche dramatiquement du danger d'une guerre mondiale L'achat d'armes et d'armements par les États-Unis a augmenté de 2,3 % pour atteindre 916 milliards de dollars, confirmant le pays en tête du classement mondial avec 37 % des dépenses militaires mondiales. En Chine, en deuxième position avec 296 milliards (12 % du total), l'augmentation a été de 6 %, tandis qu'en Russie, elle a même été de 24 %, un bond dû à la guerre en Ukraine qui l'a portée à 109 milliards. L'Ukraine envahie (plus 51 %, 64,8 milliards) et la Pologne voisine (plus 75 %), mais aussi Israël (plus 24 %), ont évidemment connu de fortes augmentations. Continuer la lecture | |
|
CELEBRER !
Attentes en vue du SynodeLe problème de la synodalité ne peut être résolu par le dépassement souhaité d'une mentalité cléricale invétérée. Un changement de la législation canonique est indispensable. Le long du chemin synodal, il y a eu des questions, des problèmes, des besoins de réforme de l'Église, qui ont suscité de nombreuses attentes, maintenant concentrées sur la deuxième session du Synode et sur les décisions que le Pape prendra par la suite. Les attentes sont nombreuses, trop nombreuses pour que certains ne soient pas déçus. Mais si celles qui sont les plus pertinentes par rapport au thème du Synode, à savoir la promotion de la synodalité, ne trouvent pas de réponse, ce serait un pas en arrière au lieu d'un pas en avant. Beaucoup de bruit pour rien ? La promotion de la synodalité vise à la maturation de la foi et de la spiritualité des fidèles. Dans le développement de la vie, la personne humaine sort de la condition de minorité quand on lui reconnaît la capacité de décider, pour elle-même et avec d'autres, de la vie de la communauté. Aujourd'hui, au contraire, selon le Code de droit canonique, les fidèles, y compris les diacres et les prêtres, ne disposent, même dans les domaines où la doctrine et la discipline des sacrements ne sont pas en jeu, d'aucune instance où leur soit reconnue la capacité de décider par un vote ce qui concerne la vie du diocèse. Ni les fidèles laïcs, dans la vie de la paroisse. Continuer la lecture | |
|
PASSER A L'ACTION
L'essence du pain est la vérité de l'espritDans les religions, il a toujours été un symbole de solidarité. Le manger ensemble, c'est partager. Ne pas en avoir, c'est souvent aussi être dénié du droit à un nom et à une parole : preuve d'un vide humain et spirituel. Un drame chrétien est un pain sans solidarité. Prenons le thème de la table commune qui touche les premiers siècles du christianisme. La table réunit, dans le souvenir du repas, mais aussi dans l'agapè partagée, des personnes qui se disent chrétiennes, issues de différents milieux sociaux et religieux. Juifs et non-Juifs, personnes de différents horizons : les différences, cependant, deviennent évidentes à la table commune, non seulement à cause des interdits alimentaires, mais aussi à cause des coutumes des différentes classes sociales et de la qualité de la nourriture. À Corinthe, la table commune pose de sérieux problèmes : les gens ont du mal à manger ensemble. Manger ensemble, c'est se reconnaître comme appartenant à un même monde et comme étant solidaire d'une même famille. Dans les décennies qui ont suivi Vatican II, un verset de la Didaché, texte datant de la fin du Ier siècle et du début du IIe siècle, perdu et redécouvert à la fin du XIXe siècle, a été remis à l'honneur : « Si nous partageons le pain du ciel, comment ne partagerions-nous pas celui de la terre ? » Continuer la lecture | |
|
CONNAITRE MIEUX L'ONU
CIJ et CPI : que sont-elles ?Dans ces mois de guerre entre Israël et Hamas on parle souvent de la Cour internationale de Justice (CIJ) et de la Cour pénale internationale (CPI) avec une superposition des fonctions et décisions qui peuvent générer de la confusion quand en réalité les deux Cours ne doivent pas être confondues. La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé son activité en avril 1946. Cette Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est le seul des six organes principaux de l’ONU à ne pas avoir son siège à New York (Etats-Unis d’Amérique). La mission de la Cour est de régler, conformément au droit international, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et de donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent lui poser les organes et les institutions spécialisées de l’ONU autorisés à le faire. Cette Cour se compose de quinze juges, qui sont élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU. Ces deux organes votent en même temps, mais dans des locaux séparés. Pour être déclaré élu, un candidat doit avoir obtenu la majorité absolue dans l’un et l’autre des organes, ce qui requiert parfois plusieurs tours de scrutin. Ses langues officielles sont le français et l’anglais. Continuer la lecture | |
|
TEMPS D’ESPERANCE
Faire fortune en chameauxAli était un homme qui désirait ardemment parcourir le monde pour découvrir des contrées étrangères et faire fortune. Il dit à sa femme : « Demain, je partirai dans le monde ». Elle ne voulait pas qu'il parte, mais elle était trop sage pour essayer de l'en empêcher. Conte populaire de Somalie qui enseigne la richesse des bons conseils. Le lendemain matin, Ali partit à pied et marcha jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui l'emploierait pour une courte période. Depuis cet emploi, il en trouva un autre, puis un autre, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait visité beaucoup de pays étrangers. Sur l'argent qu'il gagnait, il en dépensait un tiers pour se nourrir et économisait les deux tiers restants. Enfin, son épargne fut récompensée et il put acheter trois chameaux avec ses économies. Alors qu'Ali se promenait avec ses trois chameaux, il rencontra un autre voyageur. Le voyageur lui dit : « Bonjour ». Ali lui répondit : « Je te salue ». Ils se dirent l'un à l'autre d'où ils venaient, puis le voyageur dit : « Si tu me donnes un cadeau, je te dirai quelque chose de précieux ». Ali donna au voyageur l'un des trois chameaux. Continuer la lecture | |
|
POUR REFLECHIR
« Le victimisme est devenu une source d'autorité »La philosophe américaine Susan Neiman, qui dirige l'Einstein Forum de Potsdam depuis 2000, vient de publier ‘Left is not woke’ (La gauche n’est pas woke - Debate, 2024), une défense de la gauche éclairée et une critique des ennemis de la raison. Plutôt que de critiquer le mouvement ‘woke’ - qu'elle refuse de définir car elle le juge incohérent - son livre défend certains aspects des Lumières qu'elle estime en danger : de l'universalisme des valeurs à la notion de progrès ou à l'idée que la raison est émancipatrice et non un instrument de domination comme le suggèrent ses détracteurs. Interview. Il y a toujours un débat sur ce qu'est exactement le mot ‘woke’. Une définition courte pourrait être « la politique identitaire de gauche », c'est-à-dire la politisation des identités concrètes qui sont essentialisées. Tout d'abord, je n'utilise pas le concept de politique identitaire. Je pense qu'il est erroné et que nous devons cesser de l'utiliser. Je parle plutôt de tribalisme. Mais ce n'est qu'un des problèmes de l'expression ‘woke’. Il y a deux autres problèmes pour lesquels je pense que le ‘woke’ se rapproche d'une vision réactionnaire et je les aborde dans le livre, à savoir la distinction entre la justice et le pouvoir et la question du progrès humain. Je pense que ces questions sont plus importantes que la question de l'identité, mais elles sont moins abordées. Deuxièmement, je ne pense pas qu'il soit possible de définir le ‘woke’, car il s'agit d'un concept incohérent. L'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre était de me l'expliquer. Le ‘woke’ est construit sur une base d'émotions très à gauche (être du côté des opprimés, redresser les torts du passé), avec lesquelles j'étais et je suis toujours d'accord. Le problème est que les émotions sont complètement séparées des idées. Et on utilise des idées très réactionnaires. Continuer la lecture | |
|
RESSOURCES
Les défis de l'Afrique dans un monde globalLe « multi-alignement » semble être un mot clé dans les récents choix géostratégiques de plusieurs pays africains. C'est certes une option intéressante, mais qui doit être combinée avec un panafricanisme nouveau et concret. L'année 2023 sur le continent africain a vu l'ouverture de nombreux chantiers mondiaux qui méritent attention et beaucoup de travail de mise en œuvre. Il y a au moins trois événements internationaux qui peuvent représenter des tournants significatifs pour la projection panafricaine dans la dynamique mondiale. Le premier est l'Assemblée générale des Nations unies qui, en février 2023, a voté à une écrasante majorité une résolution appelant au retrait « immédiat » des troupes russes qui ont envahi l'Ukraine un an plus tôt et à une paix « juste et durable ». Le texte a reçu 141 votes favorables sur 193 États membres. Sept pays ont voté contre : la Biélorussie, la Syrie et la Corée du Nord, alliés traditionnels de la Russie, ainsi que le Nicaragua, l'Érythrée et le Mali. En général, parmi les pays qui se sont abstenus, beaucoup étaient africains, notamment l'Angola, l'Éthiopie, l'Algérie, la Guinée et le Mozambique. Ces positions s'expliquent par les relations traditionnelles entre certains États de tradition socialiste et l'Union soviétique, et donc la Russie. Ces abstentions signalent cependant le retour d'une forme de « multi-alignement » dans un contexte international où les partenariats se multiplient et se diversifient. Continuer la lecture | |
|
TEMOIGNAGE
Soudan, le conflit s'aggrave mais les Comboniens relancent l'assistance et l'éducationLa communauté internationale dénonce les niveaux de violence atteints au Darfour et le risque de famine qui frappe tout le pays. A Port Soudan, l'Eglise continue à soutenir des centaines de milliers de réfugiés et les cours du Comboni College ont été réactivés. Père Stonfer : 'L'inflation aggrave la crise alimentaire mais les élèves de nos écoles se portent bien'. Les étudiants, l'école, le bourdonnement des salles de classe bondées, les services religieux auxquels on assiste avec « une grande joie » et les œuvres caritatives. A son retour au Soudan, il y a dix jours, le Père Norberto Stonfer, missionnaire combonien d'origine italienne, a retrouvé l'atmosphère du Comboni College de Khartoum qu'il avait quitté à la veille de la guerre civile, qui a éclaté en avril 2023, pour aller se faire soigner en Italie. Le déménagement à Port Soudan « Entre les murs du collège catholique, on n'a pas l'impression d'être dans un pays en guerre », dit l'ecclésiastique, « si ce n'est que toute l'université a déménagé à Port-Soudan », ainsi que la plupart des ecclésiastiques qui animaient l'Église dans la capitale Khartoum. Le père Norberto répond à Radio Vatican-Vatican News depuis la ville portuaire soudanaise de la mer Rouge qui, depuis le début du conflit entre l'armée et les rebelles des Forces de soutien rapide (FSR), a accueilli des centaines de milliers de réfugiés fuyant les combats, ainsi que de nombreuses installations de l'Église soudanaise. Continuer la lecture |

- Butembo (MJL) – RD-Congo
- Partagez vos suggestions, opinions, doutes et idées en écrivant à pezzijp@hotmail.com
- Vous pouvez, vous abonner aussi en écrivant à pezzijp@hotmail.com
- Consulter www.comboni.org
- Copyright © www.jpic-jp.org