Chevron a quitté l'Equateur en laissant 300 dollars et la forêt détruite.
IPS 02.08.2023 Fernanda Sandéz Traduit par: Jpic-jp.orgComment se fait-il que les Équatoriens aient voté massivement contre l'exploitation de la réserve de Yasuní ? Les milliards de leur pétrole ne seraient-ils pas nécessaires au budget de l'État ? Ce n'est pas ce que pensent les Équatoriens car...

La photo date d'il y a quelques années. La femme - jeune, encore avec des cheveux très noirs - est au milieu de la forêt, précisément dans la région de Lago Agrio, au cœur de l'Amazonie équatorienne. Elle montre la paume de sa main noire à la caméra qu’elle fixe sans sourire. Et il n'y a pas de raison de le faire : ce qui fait disparaître sa main et ses doigts en plein jour, c'est en fait du pétrole.
Le géant pétrolier américain Chevron a quitté le site après des années d'exploitation. Les conséquences environnementales et sociales se font encore sentir aujourd'hui. « Des gens organisent même ce qu'on appelle des 'tours toxiques' pour visiter la zone. Cette photo a été prise lors d'une de ces visites. Là-bas, quand on plante un bâton dans le sol, ce n'est pas de l'eau qui sort, mais du pétrole », raconte Adoración Guamán, l'avocate équatorienne-espagnole qui dénonce depuis des décennies ce qu'elle n'hésite pas à qualifier d' « architecture juridique de l'impunité ».
Aujourd'hui, en effet, et après avoir été condamnée en 2011 par un tribunal équatorien dans un procès qui a duré huit ans, ayant compté six juges et accumulé plus de 220 000 pages, l'entreprise a fini par être blanchie par un tribunal néerlandais.
Conclusion : c'est maintenant l'Équateur qui doit dédommager l'entreprise. « Les personnes touchées par la pollution, elles, n'ont toujours pas vu un seul dollar », explique-t-elle. En plus d'être une militante des droits de l'homme, Guamán - la femme de la photo à Lago Agrio - est une experte du commerce international, des chaînes d'approvisionnement et de l'esclavage moderne.
Elle est professeur dans plusieurs universités d'Amérique latine, a été conseillère du gouvernement équatorien sous la présidence de Rafael Correa (2007-2017) et se bat depuis des années pour la création d'un instrument juridique international et contraignant capable de réaliser ce qui est si difficile : faire en sorte que les entreprises transnationales, qui violent les droits de l'homme et provoquent des catastrophes environnementales loin de leur siège, répondent de leurs actes, dédommagent les victimes et ne restent plus éternellement impunies.
C'est aussi pour cette raison que Guamán - qui est professeur de droit du travail à l'université de Valence, titulaire de deux doctorats et auteur de 75 articles scientifiques sur le sujet - fait partie, depuis une décennie, d'une initiative au nom prometteur : « Campagne mondiale pour la récupération de la souveraineté des peuples, le démantèlement du pouvoir des transnationales et la fin de l'impunité ». Rien de moins.
« D'ailleurs, depuis juin 2014, les Nations unies ont voté pour aller de l'avant avec la création d'un instrument à cette fin », explique-t-elle.
Où en est ce projet ?
R/. Bien que le processus à l'ONU ait commencé en 2014, les luttes populaires étaient en cours depuis longtemps, avec les tribunaux populaires, etc. Ce qui s'est passé en 2014, c'est qu'une résolution (269) a été adoptée pour créer un groupe de travail à ce sujet. Celui-ci a été promu par l'Équateur et l'Afrique du Sud et a déjà tenu huit sessions ; la neuvième aura lieu en novembre 2013.
À l'époque, en 2014, l'Équateur voulait non seulement être le chef de file de la région en matière de droits de l'homme, mais aussi contrôler le pouvoir des entreprises, un mandat inscrit dans sa constitution. Tout cela a été très marqué par l'affaire Chevron.
L'idée de l'ancien président Correa et de son ministre des affaires étrangères était de faire en sorte que le droit international relatif aux droits de l'homme puisse être modifié afin d'établir des instruments qui permettraient aux grandes économies qui contrôlent le monde d'avoir des obligations et des responsabilités en matière de droits de l'homme et de la nature. Cette initiative a été soutenue par divers groupes de la société civile et - lors d'une consultation sans précédent et à la stupéfaction de l'Union européenne - ils ont organisé une votation et l'ont emporté. L'UE, le Japon et, bien sûr, les États-Unis ont voté contre. Tout avait bien commencé, mais huit ans plus tard, le chemin à parcourir est encore long.
Comment cela se fait-il ?
R/. Après les élections et le virage à droite du gouvernement équatorien, les choses ont commencé à se compliquer. Il y avait des batailles qu’on ne voulait pas faire - celle pour obtenir que ce traité soit contraignant, par exemple - et l'Amérique latine ne faisait pas et ne fait pas partie de cette discussion. Ainsi, après huit sessions, nous avons un texte qui est en train d'être amendé et la présidence du groupe, assurée par l'Équateur, laisse à désirer. Elle n'a pas pu ou n'a pas voulu tenir des réunions vraiment productives.
Nous avions demandé la création d'un comité ou d'un tribunal qui pourrait sanctionner directement les entreprises, comme c'est le cas avec la Commission des crimes internationaux, ou encore l'ouverture d'une chambre spéciale dédiée à cette question au sein de la Cour internationale de justice, comme l'avait proposé la France.
Mais, après le changement de gouvernement en Équateur et l'arrivée au pouvoir de Lenin Moreno (2017-2021), le document que nous avions rédigé - où nous avions inclus des obligations pour les entreprises - a été écarté et c'est un texte sans mordant qui a été présenté. Un texte dans lequel les entreprises n'apparaissent plus comme des sujets d'obligation directe. Un texte décaféiné qui insiste sur les obligations des États et dans lequel la primauté des droits de l'homme est supprimée. En outre, toute référence à la création d'une cour est supprimée et il n'est pratiquement pas fait mention d'un comité. Tout cela n'est pas du tout transparent. On ne sait même pas qui a rédigé ces textes.
À ce jour, il n'y a pas de sanctions internationales ni de justice pour les victimes, à l'exception de quelques accords économiques extrajudiciaires. Qu'est-ce qui continue à vous donner de l'espoir ?
R/. Pour moi, il y a deux points d'espoir clairs. D'une part, la mobilisation sociale se poursuit. Partout dans le monde, les organisations sociales s'opposent aux entreprises transnationales et leurs voix sont de plus en plus entendues.
Il y a seize ans, ces voix ciblant les transnationales n'étaient pas écoutées ni dans les médias ni dans les cercles académiques. A ceux qui dénonçaient l'impunité ou le pouvoir mondial des entreprises on faisait la sourde oreille. Aujourd'hui, avec la seule lutte pour ce traité contraignant, nous avons réussi à mettre sur la table des négociations le fait que ces puissances existent, qui - comme l'a dit Salvador Allende - sont des puissances supra-étatiques, qui dirigent le monde et qu'il est impossible d'arrêter. Face à cela, il y a la lutte sociale. Mais en même temps, dans le cadre national, il y a de nombreuses initiatives qui donnent des résultats.
Lesquelles ?
R/. La loi française sur le devoir de vigilance commence à produire des résultats. Il en va de même pour la loi allemande. En Espagne, nous sommes également en train d'en élaborer une et en Amérique latine, il existe de nombreuses initiatives réglementaires dans ce sens.
En outre, il y a des réalisations dans les tribunaux internationaux et dans les litiges relatifs au climat et aux droits de l'homme, par exemple. Il existe des données provenant d'organisations sociales qui ont poursuivi de nombreuses entreprises devant des tribunaux internationaux. Et elles gagnent. De nombreuses transnationales ont été mises au pied du mur et, avec ou sans accord contraignant, de nombreux progrès continuent d'être réalisés. Le processus est lent et ne sera pas facile, car il touche directement au noyau dur du capitalisme transnational. Aujourd'hui, il peut sembler que l'impunité perdure, mais ce n'est pas le cas au niveau social.
Quel est le rôle des consommateurs dans tout cela ?
R/. C'est une question dont nous avons beaucoup discuté : pendant de nombreuses années, il y a eu une tendance, lorsqu'il est devenu évident que la responsabilité sociale des entreprises n'était qu'un lifting, selon laquelle la responsabilité devait incomber en premier lieu à l'acheteur. Cependant, si la sensibilisation du public à la consommation est très importante, c'est en fait à l'État qu'il incombe de la concrétiser. On ne peut pas rendre les gens seuls responsables de la consommation de biens qui devraient être interdits précisément parce qu'ils ont été produits sur la base de graves violations des droits de l'homme ou de l'environnement. En effet, lorsqu'un bien ou un service est taché de sang ou est produit en détruisant la nature, l'État doit faire quelque chose.
Existe-t-il de bons exemples en la matière ?
R/. La loi néerlandaise sur la diligence raisonnable - qui n'a pas encore été adoptée - va un peu dans ce sens. Elle propose que les consommateurs puissent acheter « en toute tranquillité d'esprit ». Elle dit explicitement : « cette loi vise à permettre aux consommateurs d'acheter en toute tranquillité d'esprit ». Mais ce n'est pas pour cela que je me bats, ce n'est pas pour que les consommateurs puissent acheter en toute tranquillité. Ce que je veux, c'est que l'État assume la responsabilité sur la manière dont les entreprises importent pour vendre (sur son territoire ou ailleurs), pour produire de la plus-value sur la base de la violation des droits, quel que soit l'endroit où elle est commise.
Mais que fait-on maintenant que les entreprises sont dans les gouvernements ?
R/. L'accaparement des pouvoirs publics par les entreprises est un phénomène qui, malheureusement, se produit partout, de cette dame dont le frère faisait du trafic de masques au ministre du travail issu du secteur de la banane, etc. Cependant, le fait que nous ayons des règles qui peuvent garantir que - au-delà de cela - il y a une loi, c'est déjà quelque chose.
C'est pourquoi je les appelle les « lois de tranchées » : parce qu'elles sont adoptées sous des gouvernements progressistes de sorte que, lorsque des gouvernements conservateurs arriveront, elles seront là. Jusqu'à ce qu'elles soient abrogées, du moins. Lorsque j'ai fait partie d'un gouvernement, j'ai participé à l'enracinement de ces politiques sociales.
Comment s'est déroulé le procès contre Chevron ?
R/. C'était ma première affaire dans ce domaine et je m'y suis intéressée relativement tard, alors que le premier procès avait déjà eu lieu. Je suis très amie avec Pablo Fajardo, l'avocat du plaignant, et je me suis impliquée dans l'affaire dans le cadre de l'Union des avocats pour Chevron Texaco (Udat). J'ai eu l'occasion de travailler avec eux sur le terrain et c'est ce qui m'a ramenée en Equateur. Et c'est en découvrant la barbarie qu'ils avaient commise que je me suis encore plus impliquée. Après que les personnes concernées aient poursuivi Chevron et gagné leur procès, en 2011, avec un jugement définitif, Chevron est parti, laissant 300 dollars sur le compte et la forêt détruite. Et, comble de l'absurde, aujourd'hui - en raison du jugement d'un tribunal néerlandais en 2018 - c’est l’Equateur qui doit payer. C'est de l'impunité.
Voir, Chevrón se fue de Ecuador dejando 300 dólares y la selva destrozada










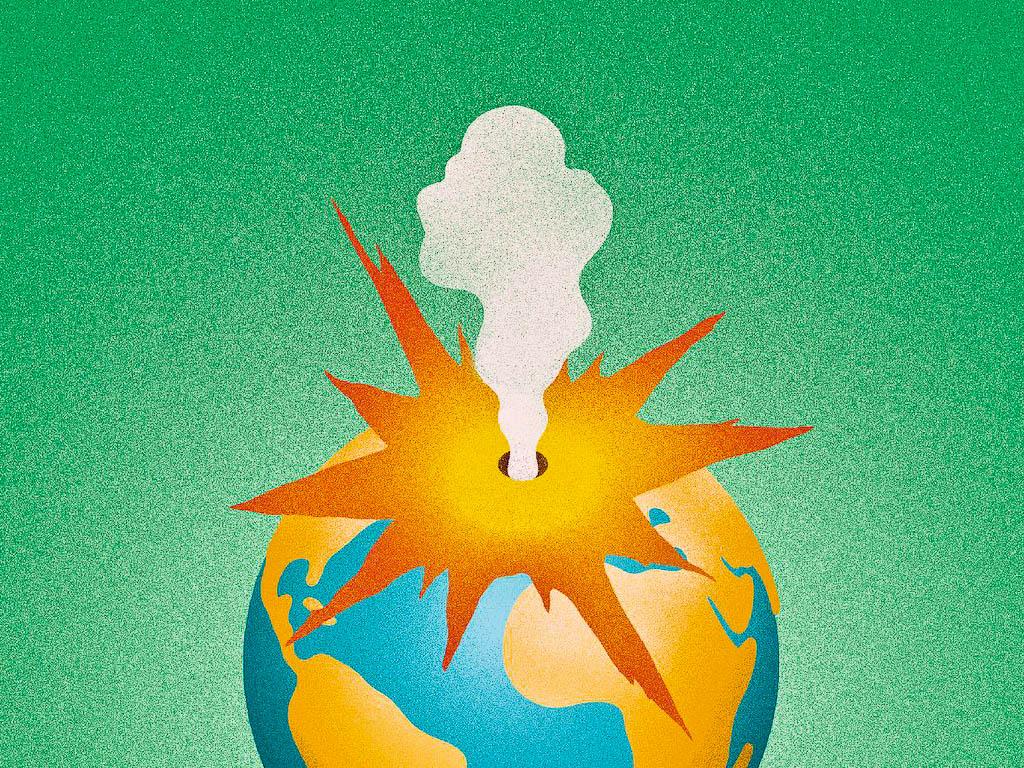










 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire