Le flop de Belém
http://www.valori.it 24.11.2025 Andrea Barolini Traduit par: Jpic-jp.orgLa COP30 s’est terminée sur un échec total. Chacun pour soi. Il n’y a pas d’autre manière de décrire la trentième Conférence mondiale sur le climat des Nations unies, qui s’est conclue samedi 22 novembre à Belém, au Brésil. La COP30 a été, disons-le, surréaliste et chaotique sous de nombreux aspects. Alors vraiment, vous n’en avez rien à faire ?

Tentons une synthèse presque impossible. Dans les premiers jours, nous nous sommes tous, en réalité, fait des illusions. La présidence brésilienne avait en effet publié des textes provisoires qui contenaient « aussi » certaines options franchement ambitieuses, en particulier sur ce qui avait été proclamé comme l’objectif principal de la COP30 : adopter une feuille de route pour sortir des énergies fossiles. C’est ce « aussi » que beaucoup ont sous-estimé.
Aucun résultat sur les énergies fossiles ni sur la déforestation
Face à ces options ambitieuses, il y en avait trop qui ne l’étaient pas du tout. Et surtout beaucoup trop de « no text », signifiant que certains gouvernements demandaient de sauter purement et simplement des questions. Ainsi, à deux jours de la fin de la conférence, est arrivée la douche froide. Toute hypothèse visant à donner corps à la formule anodine et vague (mais, deux ans plus tard, il faut le dire, providentielle) sortie de la COP28 de Dubaï – transitioning away from fossil fuels – a été abandonnée. Les mots fossil fuels ne figuraient plus dans aucun passage du texte provisoire.
Glacial, par rapport aux premiers jours de négociations, durant lesquels le dynamisme de la présidence brésilienne – prête même à bousculer les protocoles pour parvenir « au résultat » – avait vraiment laissé espérer une issue positive. En lisant cette version tellement plate et vidée de substance, beaucoup ont même imaginé une tactique : « Et si la présidence avait fait cela pour rebattre les cartes ? ». La stupéfaction fut si grande qu’on tenta d’y voir une stratégie.
Et pourtant non. La réalité était et reste tout simplement qu’il n’y a pas d’accord au niveau mondial. La nécessité de dépasser la dépendance au charbon, au pétrole et au gaz n’est pas partagée par tous. Surtout pas par les pays qui brûlent l’immense majorité de ces ressources fossiles : États-Unis, Chine, Inde et Russie. Et oui, bien sûr : pour la Chine il faudrait tenir un discours différent, puisque la position de Pékin n’est pas celle de Washington, nul doute là-dessus. Mais en réalité, il faut bien reconnaître que « deux pays suffiraient pour résoudre le problème du changement climatique » (au moins du point de vue de l’atténuation), comme l’a suggéré à Belém Tommaso Perrone, l’un des journalistes les plus expérimentés sur les COP et les négociations.
Les résultats obtenus à la COP30 dont nous ne pouvons pas nous contenter
Voilà ce qu’est le « chacun pour soi ». Sur la sortie des énergies fossiles, ceux qui disent « non » sont les pays qui les extraient, les vendent et/ou en dépendent fortement. Sur les transferts de fonds et de technologie en faveur des pays en développement, ceux qui disent « non » sont ceux qui ont prospéré pendant près de deux siècles en dévastant la planète. Sur les indemnisations pour pertes et dommages subis par les nations les plus vulnérables de la Terre, même chose.
Même sur la déforestation aucun résultat n’a été obtenu, alors même qu’il s’agissait de la première COP « aux portes de l’Amazonie ». Et il ne faut surtout pas — plus encore : il ne faut pas du tout ! — se satisfaire du fait que le texte final évoque un « appel » (qui n’a rien d’obligatoire) à tripler les fonds pour l’adaptation d’ici 2035 (cinq ans plus tard que dans la version précédente). Ni du fait qu’on lance un Global Implementation Accelerator (Accélérateur mondial d’implémentation), sans expliquer ni ce que c’est, ni comment cela fonctionnera, mais en précisant très clairement qu’il sera de nature volontaire.
Faudrait-il, alors, se réjouir parce qu’il a été timidement demandé aux gouvernements de revoir leurs promesses de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque celles en vigueur nous conduiraient, au mieux, à 2,3–2,5 degrés de réchauffement global ? Ou parce qu’a été lancée la Belém Mission to 1.5°C, là encore sans expliquer de quoi il s’agira et en indiquant que l’on en reparlera à la COP31 ? Ou parce que, péniblement, a été acceptée l’idée de créer un Just transition mechanism pour renforcer la coopération internationale en faveur d’une transition équitable ? Ce serait comme se satisfaire qu’à un malade du cancer en phase avancée on concède un dixième de cycle de chimiothérapie.
À la dernière plénière de Belém, les esprits se sont échauffés
Sincèrement, allons-nous plaisanter ? Pour juger quelque chose, il est toujours bon de prendre du recul et de regarder la « vue d’ensemble ». À la COP30, il a même fallu pousser un soupir de soulagement parce qu’a été rappelé l’objectif de limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à un maximum de 1,5 degré ! Objectif qui paraissait pourtant acquis depuis longtemps, même après que le GIEC avait expliqué (dans son rapport spécial 1.5, en octobre 2018 !) que la différence entre 1,5 et 2 degrés équivaut à passer d’une crise à une catastrophe.
Chacun pour soi, disions-nous. Et c’est ainsi, en réalité, depuis une décennie (à partir de la COP22 de Marrakech). Un égoïsme de fond qui jusque-là avait été — pas toujours, mais souvent — masqué par des compromis et par la politesse diplomatique. Qui a spectaculairement disparu durant la dernière plénière de la COP30, avec des nations qui ont littéralement tapé du poing sur la table, avec accusations croisées et doigts pointés. Comme dans une réunion de famille forcée où, à un moment, soudainement, tous les ressentiments explosent de façon fracassante. Et oui, c’est vrai, au fond, c’est aussi cela le multilatéralisme. Mais pendant ce temps, le temps passe, et à force de se contenter d’avancer au ralenti, nous nous réveillerons quand il sera trop tard (comme si ce n’était pas déjà trop tard).
L’éléphant dans la pièce dont on ne parle jamais
Mais il y avait un éléphant dans la salle, lors de cette plénière, dont nous oublions trop souvent l’existence. Parce que ce « chacun pour soi » a une matrice culturelle claire, indiscutablement ancrée dans notre modèle de développement. La COP30 n’a été rien d’autre que le miroir d’un système prédateur, colonial, individualiste et orienté uniquement vers l’objectif de maximiser profits, gains personnels et intérêts particuliers. Intérêts différents, parfois opposés, mais auxquels personne ne veut renoncer. C’est l’économie capitaliste et ultra-libérale qui pousse dans cette direction : chaque gouvernement a, de fait, mandat de faire ce qui est le mieux pour son propre microcosme local.
Et non, ce n’est pas du maximalisme, ce n’est pas de l’extrémisme que de pointer le système économique. Les extrémistes sont ceux qui préfèrent détruire les équilibres de la planète plutôt que renoncer à leurs privilèges : la seule chose qui leur importe vraiment. Tant que nous ne changerons pas ce système de valeurs, nous n’en sortirons pas. C’est pourquoi se tourmenter à imaginer des réformes des COP pour dépasser les blocages est peut-être un exercice inutile sans réflexion culturelle plus large. Sans ça, on ne peut que s'aligner sur la pagaille monumentale qui a éclaté à la plénière conclusive de Belém et se le dire clairement, une fois pour toutes : le climat, pour trop de gouvernements – excusez le langage cru – ils s'en tapent royalement.
Voir, Il flop di Belém: la Cop30 è finita con un nulla di fatto









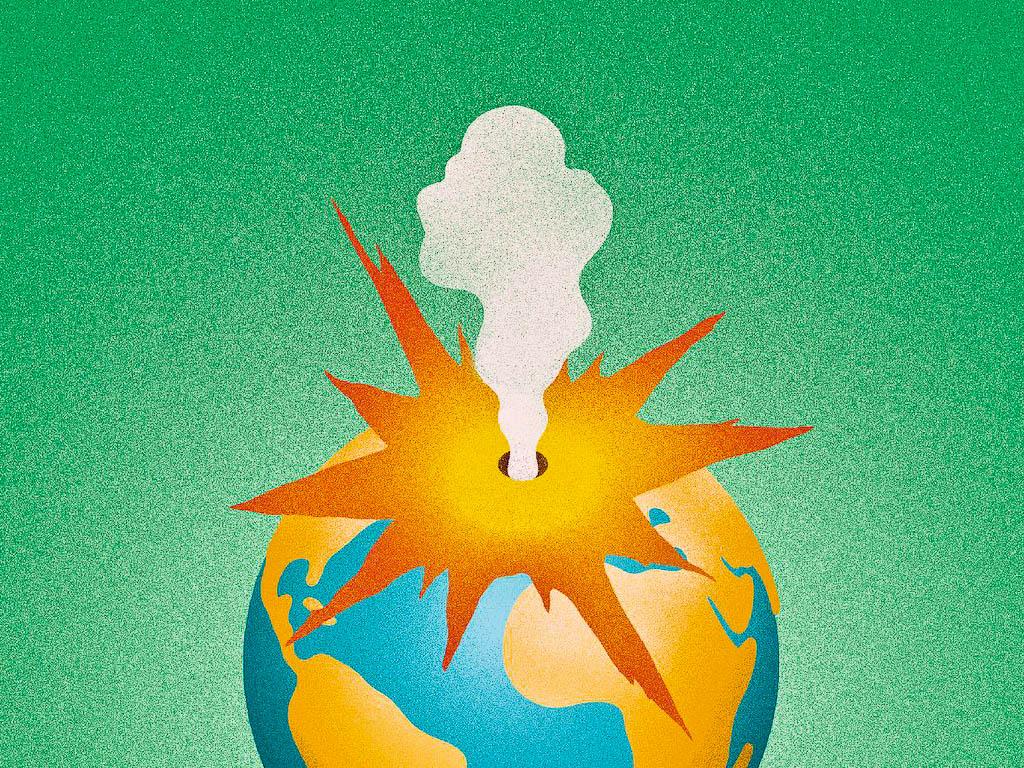
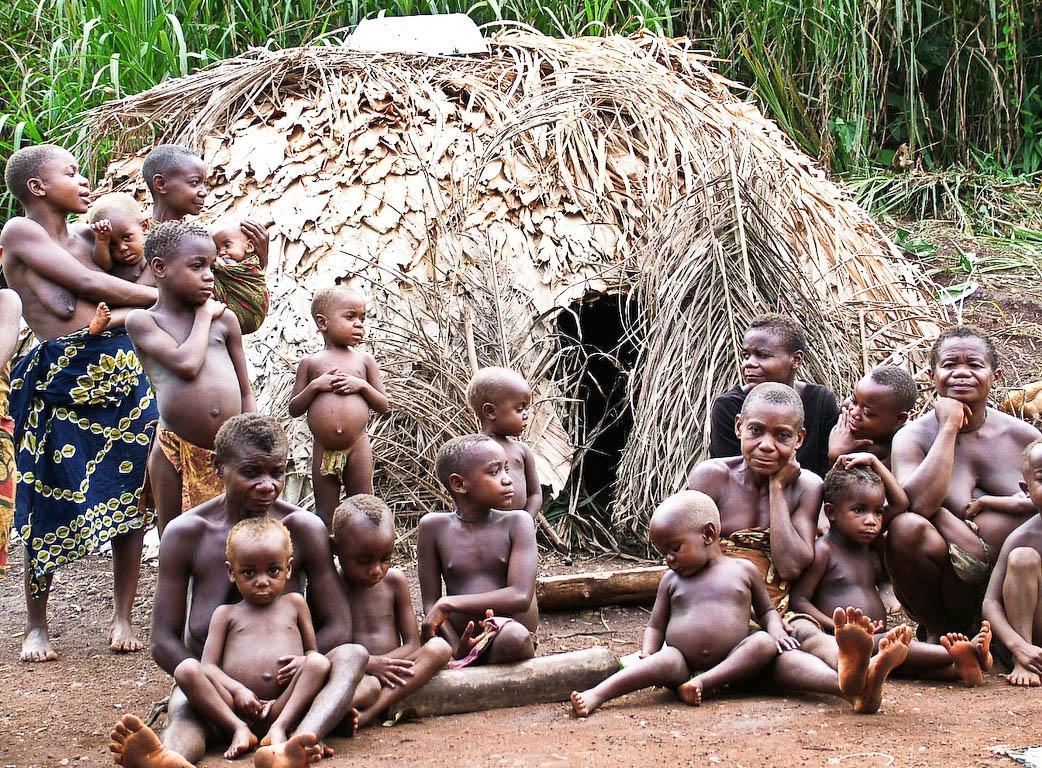










 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire