Le Sud global fait son retour
Carnegie Endowment for International 20.05.2024 Erica Hogan e Stewart Patrick Traduit par: Jpic-jp.orgLe retour de ce concept traduit une frustration persistante face aux inégalités inscrites dans l’ordre mondial. Extrait

Ces dernières années, l’idée selon laquelle l’ordre politique et économique mondial divise le monde en deux fractions inégales a refait surface sur la scène internationale. En décembre 2022, l’Assemblée générale des Nations Unies a de nouveau adopté une résolution intitulée « Vers un nouvel ordre économique international (NOEI) », appelant à raviver le NOEI des années 1970. Le résultat du vote, pour ou contre la résolution, reflétait presque exactement la Ligne Brandt qui sépare le Nord et le Sud global, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, Israël, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et l’Europe votant contre, tandis que le reste du monde votait en sa faveur, à l’exception de l’abstention de la Turquie.
La montée en popularité du terme « Sud global » reflète des griefs renouvelés contre l’ordre mondial et la nécessité, pour ceux qui sont actuellement marginalisés, de s’unir pour le réformer. Lors de la Conférence de sécurité de Munich en 2024, le président Nana Akufo-Addo du Ghana a dénoncé une instabilité inhérente à l’ordre mondial, produite par « une situation dans laquelle le soi-disant Sud global, dont fait partie l’Afrique, se retrouve toujours du mauvais côté de la balance concernant l’accès aux ressources mondiales ». Lors du sommet du G77 + Chine en septembre 2023, le président cubain Miguel Díaz-Canel a repris la rhétorique du Mouvement des non-alignés (MNA), du G77 et du NOEI, déclarant que « après tout ce temps pendant lequel le Nord a organisé le monde selon ses intérêts, il revient maintenant au Sud de changer les règles du jeu ».
En septembre 2023, dans un discours à l’Assemblée générale de l’ONU, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a observé que « les 10 % les plus riches de la population mondiale sont responsables de près de la moitié de toutes les émissions de carbone dans l’atmosphère », et pourtant « ce sont les populations vulnérables du Sud global qui sont les plus touchées par les pertes et les dommages liés au changement climatique ».
À propos du conflit à Gaza, le président colombien Gustavo Petro a affirmé : « L’Allemagne... la France, l’Union européenne, le Royaume-Uni, et surtout les États-Unis d’Amérique... soutiennent le fait de larguer des bombes sur les gens, car ils veulent démontrer à l’humanité entière que ce qui arrive à la Palestine peut arriver à n’importe lequel d’entre vous si vous osez opérer des changements sans leur permission ». Les causes politiques précises défendues par le Sud global ont évolué, mais les griefs fondamentaux restent les mêmes.
Le non-alignement est de retour
De plus, les dirigeants du Sud global manifestent une volonté et une capacité renouvelées de s’opposer aux volontés de l’Occident. De l’Amérique latine à l’Afrique, le non-alignement fait son retour comme doctrine de politique étrangère, empêchant l’Occident de construire un consensus mondial autour de la guerre en Ukraine, entre autres.
Prenons le groupe BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud jusqu’en 2024, année où il a accueilli quatre nouveaux membres (Égypte, Éthiopie, Iran et Émirats arabes unis), devenant ainsi les BRICS+. Bien que ses efforts soient encore naissants, le groupe cherche à réduire la domination des États-Unis sur le système financier mondial en se diversifiant hors du dollar et du système SWIFT, tout en établissant de nouvelles institutions financières internationales comme la Nouvelle Banque de Développement.
Avec son élargissement, le groupe se positionne comme un contrepoids potentiel au G7 et aux autres forums occidentaux. Les pays du Sud global se tournent également vers des instances internationales pour demander des comptes au Nord global, comme le montrent les affaires portées par l’Afrique du Sud et le Nicaragua devant la Cour internationale de Justice concernant la guerre entre Israël et le Hamas.
Si ce renouveau du Sud global reflète un désir de nouvelle tentative pour un ordre mondial plus équitable – tentative qui avait échoué dans les années 1980 – qu’est-ce qui a changé depuis ? Entre 1990 et 2020, un indicateur clé des inégalités (le coefficient de Gini mondial) a diminué, signalant une réduction des écarts économiques entre pays. Des pays comme l’Inde, l’Indonésie et le Brésil, traditionnellement associés au Sud global, ont acquis suffisamment de poids économique et politique pour s’imposer comme puissances régionales ou mondiales, parfois en rivalité les uns avec les autres, remettant en question l’idée d’un Sud global uni et impuissant. Ils ont aussi contourné les institutions multilatérales centrées sur l’Occident avec des regroupements comme les BRICS, tout en trouvant une voie de coopération avec le Nord global via le G20.
Pour de nombreux gouvernements du Sud global, cette amélioration économique et politique semble avoir accéléré – plutôt qu’atténué – leur désir de réalignement, car le pouvoir croissant ne s’est pas accompagné des privilèges croissants.
Par ailleurs, tous les pays en développement n’ont pas connu ce renforcement économique et politique. Tandis que certains pays se considérant comme faisant partie du Sud global ont vu leur richesse et leur influence politique augmenter considérablement, beaucoup d’autres n’en ont pas bénéficié, restant bloqués dans un statut de pays à faible revenu et exclus des prises de décisions multilatérales majeures. Par exemple, le PIB par habitant du Burundi, à 259 $ annuel, ne représente que 3,9 % de celui de la Colombie, et seulement 0,34 % de celui des États-Unis. Certains pays, comme l’Inde, ont accru leur influence mondiale, tandis que d’autres restent relativement marginalisés.
De plus, même si de nombreux pays du Sud global adoptent une rhétorique similaire sur l’ordre mondial, leurs positions restent divergentes. L’Inde et la Chine sont certes membres des BRICS, mais elles sont des rivales géopolitiques acharnées, luttant pour le leadership du Sud global. Certains analystes évoquent aussi un « Sud du Sud global », un sous-ensemble de pays plus pauvres et plus petits dominés par des puissances telles que la Chine et l’Inde, une dynamique Nord-Sud qui se reproduit au sein même du Sud global.
Compte tenu de cette diversité, les références au Sud global devraient se concentrer sur un fil conducteur constant : dès le départ, l’idée visait à relier des expériences diverses à un même grief – une économie politique mondiale qui perpétue les dynamiques coloniales et impose des hiérarchies – et à défendre un réalignement de l’ordre mondial en faveur de l’autodétermination.
Voir, A Closer Look at the Global South










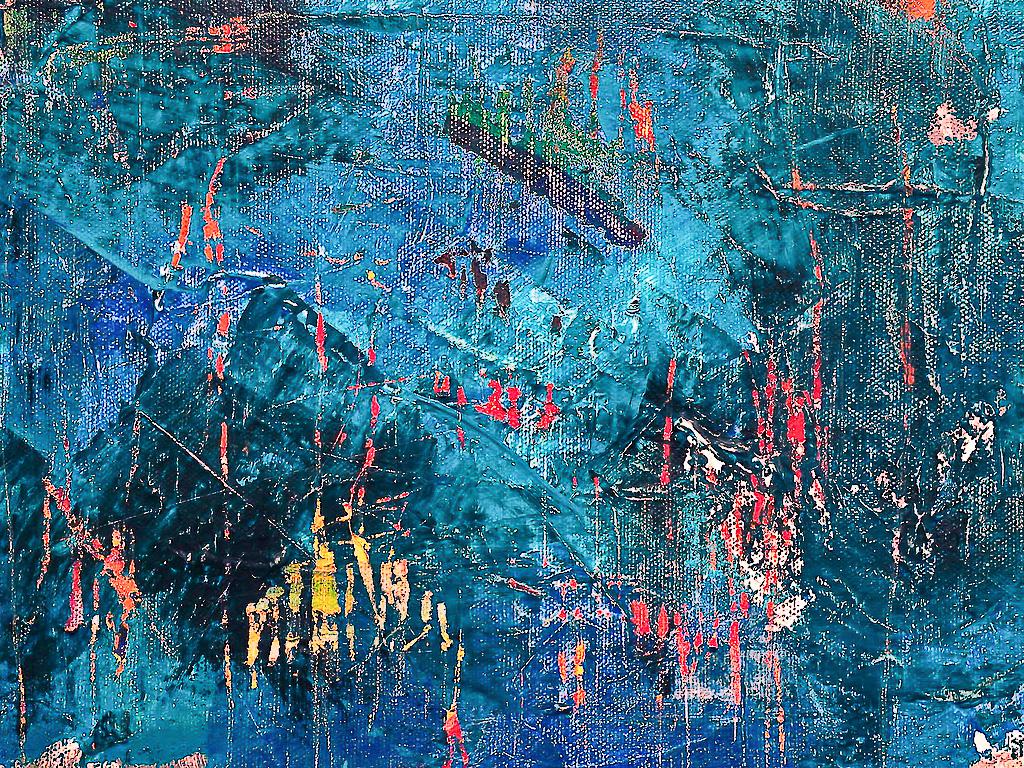



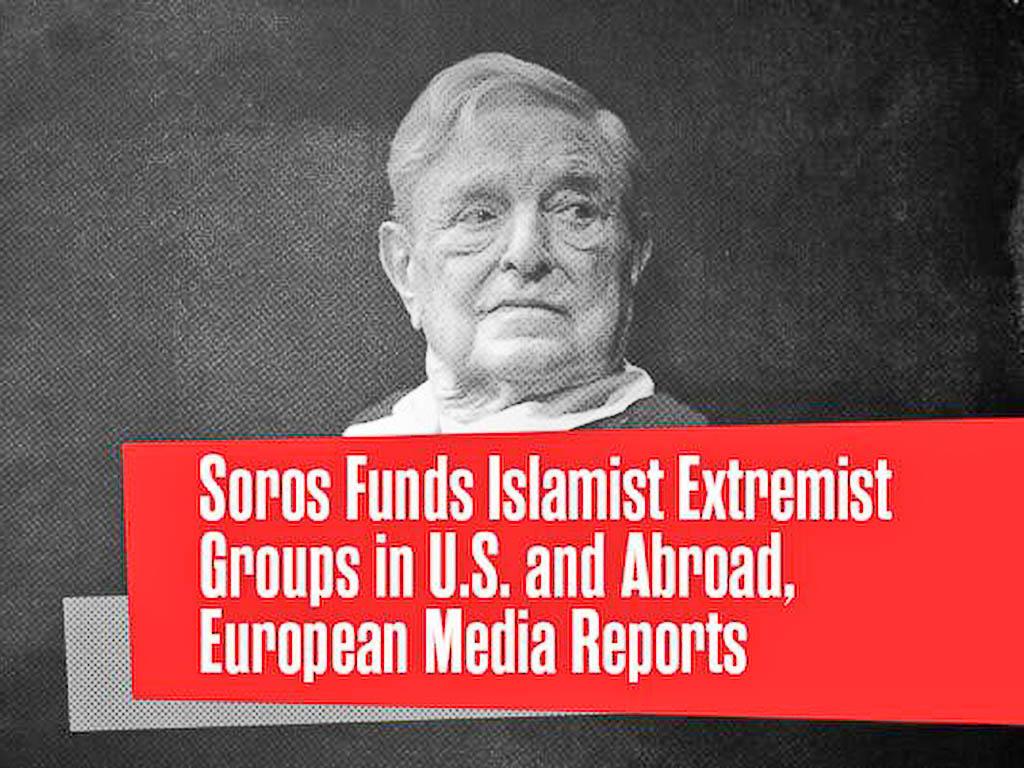






 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire