Je rêve d’un monde sans réfugiés
ChimpReports 25.06.2025 Dr. Théogène Rudasingwa Traduit par: Jpic-jp.orgJ’ai appris l’alphabet et les chiffres sous un acacia rabougri, dans le camp de Rwekubo, à l’ouest de l’Ouganda. Mon ardoise était une assiette en fer rouillée, et ma salle de classe, l’ombre mouvante des feuilles. Une bonne réflexion à l’occasion de la Journée mondiale des Migrants et des Réfugiés célébrée dans l’Église catholique les 4 et 5 octobre 2025.

Ces matins-là — la terre rouge et le sable sous les pieds nus, la morsure de la faim au ventre, le murmure obstiné de ma mère disant que « savoir, c’est être libre » — ne m’ont jamais quitté. J’ai foulé le sol rwandais à peine six années de ma vie, mais le Rwanda a habité en moi chaque instant. L’exil a façonné jusqu’à la trame de mon identité, imposant cette question qui hante tout réfugié : où est la maison quand la route ne s’arrête jamais ?
Depuis toujours, les philosophes s’interrogent sur cette énigme. Diogène se disait kosmopolites, citoyen du monde, non par orgueil mais par nostalgie d’un foyer perdu. Hannah Arendt avertissait que le réfugié du XXe siècle était « l’avant-garde de son peuple », un signe prophétique de nations ayant oublié comment protéger les leurs. La théologie elle-même est empreinte d’exil : Abraham n’entend la promesse de Dieu qu’après avoir quitté Ur ; Moïse rencontre le Buisson Ardent alors qu’il garde les troupeaux sur une montagne étrangère ; Marie, Joseph et l’enfant Jésus fuient la terreur d’Hérode en Égypte ; la hijra du Prophète Mahomet transforme la fuite en acte fondateur d’une nouvelle communauté. Même la science nous rappelle qu’homo sapiens est une espèce migratoire. La génétique raconte une ancienne impatience qui dispersa nos ancêtres de la vallée du Rift jusqu’à toutes les rives, prouvant que le mouvement est aussi naturel à notre espèce que la parole.
Cependant, se déplacer par choix est un pèlerinage ; être contraint à fuir est un tourment. Aujourd’hui, c’est le tourment qui domine. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés rapporte qu’à la fin de 2024, 123,2 millions de personnes étaient déplacées de force — dont 36,8 millions de réfugiés et 73,5 millions de déplacés internes -. Ce chiffre a encore augmenté au premier semestre 2025, atteignant environ 122 millions malgré quelques retours, soit presque le double par rapport à il y a dix ans (unhcr.org, apnews.com). L’Afrique subsaharienne porte une lourde part de ce fardeau : le Centre de Surveillance des Déplacements Internes signale 38,8 millions d’Africains déplacés à l’intérieur de leurs propres frontières, soit près de la moitié du total mondial (internal-displacement.org). La guerre civile au Soudan, à elle seule, a déplacé plus de quatorze millions de personnes, tandis que le Congo, le Mozambique, la Somalie, l’Éthiopie et le Sahel saignent en silence dans les statistiques.
Derrière chaque chiffre, il y a un visage. Pensez à Albert Einstein, qui griffonna l’équation qui courba l’univers tout en naviguant entre les exils suisse, allemand et américain. Pensez à Sigmund Freud, Hannah Arendt, Joseph Brodsky ; à Ngũgĩ wa Thiong’o écrivant Le Diable sur la croix sur du papier toilette dans une prison de Nairobi ; à Freddie Mercury se réinventant de réfugié de Zanzibar en icône du rock ; à Madeleine Albright, qui échappa d’abord à Hitler puis à Staline avant de conseiller les présidents américains. L’exil meurtrit, mais il peut aussi affiner la vision, distiller ce que les sédentaires oublient de voir. Dans les déserts, les prophètes perçoivent des buissons ardents ; dans la sauvagerie, les réfugiés entrevoient parfois des avenirs que les sociétés installées ne savent plus imaginer.
Ce paradoxe — la tribulation enfantant la révélation — alimente mon espérance. Ce n’est pas le destin qui condamne le XXIe siècle à de plus vastes vagues de déplacements ; ce sont l’échec politique, la négligence écologique et la mollesse morale. Pour stopper le déferlement, il nous faut traiter les causes, et pas seulement les symptômes. Permettez-moi d’esquisser un programme en sept points — tissés en un seul fil plutôt qu’énumérés — visant rien de moins qu’un monde où l’exil serait un choix, non une nécessité.
Premièrement, les nations doivent rebâtir l’ossature vacillante de la paix préventive. Le coût d’une médiation précoce des conflits est dérisoire comparé aux dépenses liées au maintien des camps. Deuxièmement, la souveraineté doit être redéfinie comme un devoir de protection, et non de domination : les gouvernements qui commettent des atrocités, affament leurs populations ou dépouillent leurs citoyens de leurs droits doivent faire face à des sanctions automatiques, juridiquement contraignantes — économiques, diplomatiques et personnelles — appliquées par un Conseil de sécurité revitalisé, libéré du blocage des vétos. Troisièmement, il y a urgence à instaurer une justice climatique. La science nous démontre déjà que les déserts qui avancent, les pluies qui échouent et les mers qui montent déplacent chaque année davantage de familles que les balles. Un fonds mondial d’adaptation climatique — financé par une taxe sur les profits exceptionnels des énergies fossiles — devrait acheminer directement les ressources vers les communautés vulnérables, leur permettant de rester sur place avant d’être contraintes de fuir.
Quatrièmement, les économies doivent être réformées pour encourager l’inclusion. Les systèmes de commerce équitable, l’allègement de la dette conditionné à des réformes de gouvernance, et les accords régionaux de libre circulation — comme la ZLECAf en Afrique — doivent être finalisés et appliqués pour transformer les frontières de barrières en ponts. Cinquièmement, la citoyenneté elle-même doit évoluer. Tout enfant né sans nationalité devrait recevoir le jus soli là où il pousse son premier souffle ; les voies vers la naturalisation doivent être simples, rapides et abordables ; et les passeports doivent redevenir des symboles de dignité plutôt que des instruments d’exclusion. Sixièmement, la connaissance doit circuler plus vite que les gens ne sont forcés de bouger : il faut investir dans le haut débit, les universités en accès libre, et la certification numérique, afin qu’aucune guerre ne puisse rendre orphelin l’avenir d’un étudiant ou détruire ses diplômes. Septièmement — et c’est central — la société civile doit être protégée en tant que système immunitaire de la démocratie. Là où les journalistes peuvent enquêter librement, où les Églises peuvent abriter, où les scientifiques peuvent alerter, et où les artistes peuvent se souvenir, les sociétés détectent les problèmes à temps ; là où la société civile est muselée, les crises prolifèrent dans l’ombre jusqu’à ce que les flux de réfugiés traversent les continents.
Aucune de ces propositions n’est bon marché ou simple. Mais la situation actuelle ne l’est pas non plus, si l’on compte en enfances perdues, en espoirs noyés, et en milliards que les donateurs dépensent à contrecœur pour empêcher les camps de devenir des cimetières. Ma propre vie démontre que sauver ne serait-ce qu’un enfant de la main glacée de l’exil peut mener cet enfant à servir, soigner et enseigner à beaucoup d’autres. Imaginez, alors, ce que l’humanité pourrait récolter si l’exil lui-même devenait obsolète.
Ainsi, je rêve — non comme un luxe, mais comme une obligation morale — d’une aube où le mot « réfugié » retournera aux écritures anciennes et aux archives poussiéreuses, n’étant plus ni un titre d’actualité ni un camp accroché aux lisières des déserts. Je rêve d’un Rwanda dont les fils et filles voyageront seulement par choix, dont les collines abriteront la mémoire sans le deuil ; d’une Afrique qui exportera des idées, de la musique et des innovations, et non des corps désespérés dans des embarcations de fortune ; d’un monde où l’errance redeviendra pèlerinage et non fuite. Jusqu’à cette aube, je porterai en moi le désert comme blessure et comme source, rappel que des tentes en lambeaux peuvent jaillir des visions capables de rebâtir des nations. Et je travaillerai — en tant que réfugié, médecin, enseignant et citoyen d’un avenir inachevé — à ce jour où aucun enfant n’apprendra la carte de l’exil avant d’avoir appris l’hymne de son pays.
Voir, BLOG: I Dream of a World without Refugees | ChimpReports
Contact: ngombwa@gmail.com






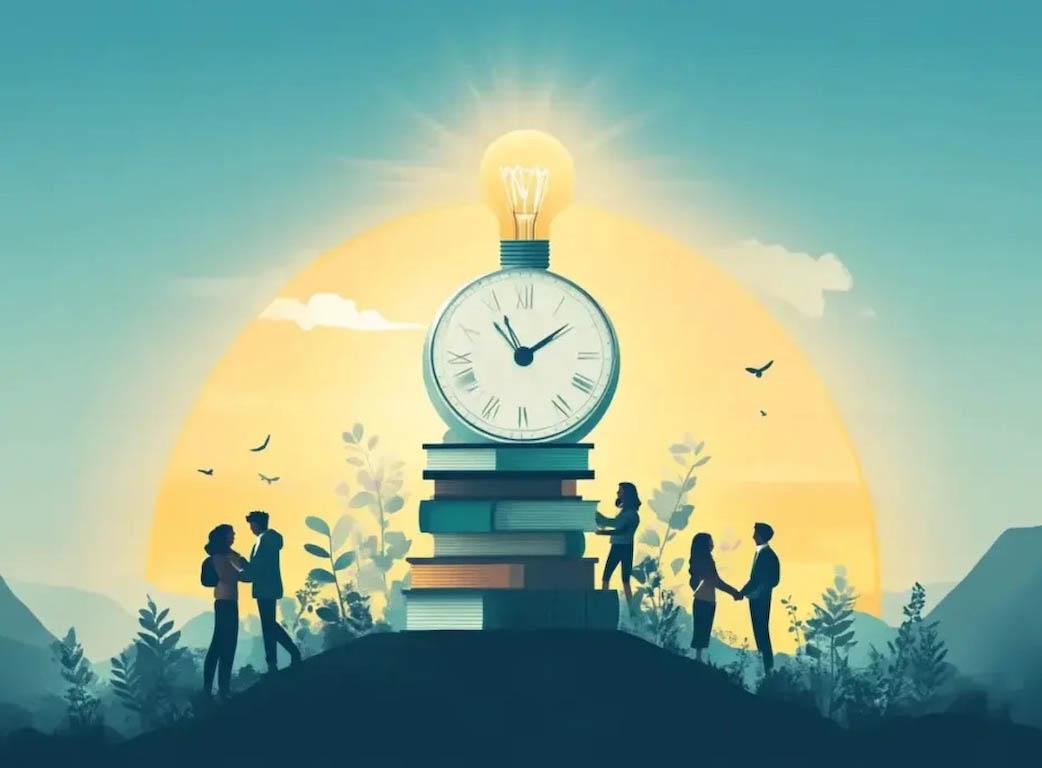






 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire