L’appel de la tribu
Ethic 01.03.2018 Mario Vargas Llosa Traduit par: Jpic-jp.orgL’héritage de Mario Vargas Llosa (1936-2025) est plus nécessaire que jamais dans un monde qui tend vers l’autoritarisme. Dans La llamada de la tribu - L’appel de la tribu (Alfaguara), le prix Nobel de littérature péruvien déconstruisait « l’esprit de la tribu » des nationalismes et des idéologies totalitaires, à travers un récit autobiographique où il retrace son parcours intellectuel et politique. Mais le libéralisme d’aujourd’hui est-il encore celui d’Adam Smith ?

Le libéralisme est une doctrine qui ne prétend pas avoir réponse à tout, comme le fait le marxisme, et qui admet en son sein la divergence et la critique, à partir d’un petit noyau de convictions claires. Par exemple, que la liberté est la valeur suprême, qu’elle est indivisible et non fragmentaire, qu’elle est une et doit se manifester dans tous les domaines – économique, politique, social, culturel – dans une société véritablement démocratique. Ce manque de compréhension a conduit à l’échec de tous les régimes qui, dans les années soixante et soixante-dix, ont tenté de promouvoir la liberté économique tout en restant despotiques, généralement sous des dictatures militaires. Ces ignorants croyaient qu’une politique de marché pouvait réussir sous des gouvernements répressifs et dictatoriaux. Mais ont également échoué de nombreux projets démocratiques en Amérique latine qui respectaient les libertés politiques, mais ne croyaient pas à la liberté économique – le marché libre –, seule source de développement matériel et de progrès.
Le libéralisme n’est pas dogmatique : il reconnaît que la réalité est complexe et que les idées et programmes politiques doivent souvent s’adapter à celle-ci pour réussir, plutôt que d’essayer de la forcer dans des cadres rigides, ce qui mène souvent à l’échec et déclenche des violences politiques. Le libéralisme a lui aussi produit une « maladie infantile », le sectarisme, incarné par certains économistes fascinés par le libre marché comme s’il s’agissait d’une panacée capable de résoudre tous les problèmes sociaux. C’est à eux qu’il faut surtout rappeler l’exemple d’Adam Smith lui-même, père du libéralisme, qui, dans certaines circonstances, acceptait temporairement certains privilèges comme les subventions et les contrôles, lorsqu’en supprimer leur usage immédiatement pouvait causer plus de mal que de bien. Cette tolérance qu’avait Smith envers l’adversaire est peut-être le trait le plus admirable de la doctrine libérale : accepter qu’elle puisse se tromper et que l’adversaire ait raison.
Un gouvernement libéral doit affronter la réalité sociale et historique avec souplesse, sans croire que toutes les sociétés peuvent être enfermées dans un seul schéma théorique, une attitude contre-productive qui mène à l’échec et à la frustration. Les libéraux ne sont pas des anarchistes et ne cherchent pas à supprimer l’État. Au contraire, ils veulent un État fort et efficace, ce qui ne veut pas dire un État tentaculaire, chargé de tâches que la société civile peut mieux accomplir dans un système de libre concurrence. L’État doit garantir la liberté, l’ordre public, le respect de la loi, l’égalité des chances.
L’égalité devant la loi et l’égalité des chances ne signifient pas l’égalité des revenus, que certains libéraux pourraient pourtant proposer. Car cette dernière ne peut être atteinte dans une société que par un gouvernement autoritaire qui « égalise » économiquement tous les citoyens au moyen d’un système oppressif, niant les différentes capacités individuelles : imagination, inventivité, concentration, assiduité, ambition, esprit de travail, leadership. Cela équivaut à la disparition de l’individu, à son absorption dans la tribu.
Rien n’est plus juste que, partant d’un point de départ plus ou moins égal, les individus voient leurs revenus différer selon qu’ils apportent plus ou moins au bénéfice de la société. Ce serait absurde d’ignorer qu’il existe des individus intelligents et d’autres stupides, des travailleurs et des paresseux, des créatifs et des routiniers, des studieux et des oisifs, etc. Et ce serait injuste que, au nom de « l’égalité », tous reçoivent le même salaire malgré leurs aptitudes et mérites différents. Les sociétés qui ont tenté cela ont écrasé l’initiative individuelle, faisant disparaître dans les faits l’individu dans une masse sans relief, démobilisée par l’absence de concurrence et privée de créativité.
Voir, La llamada de la tribu





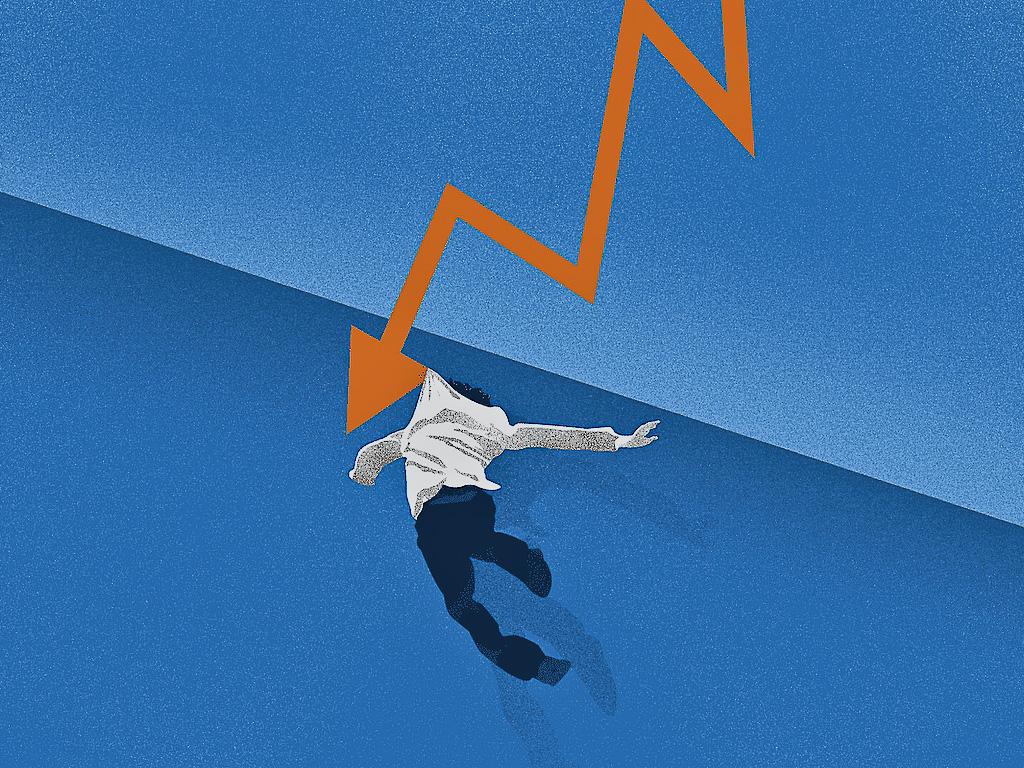
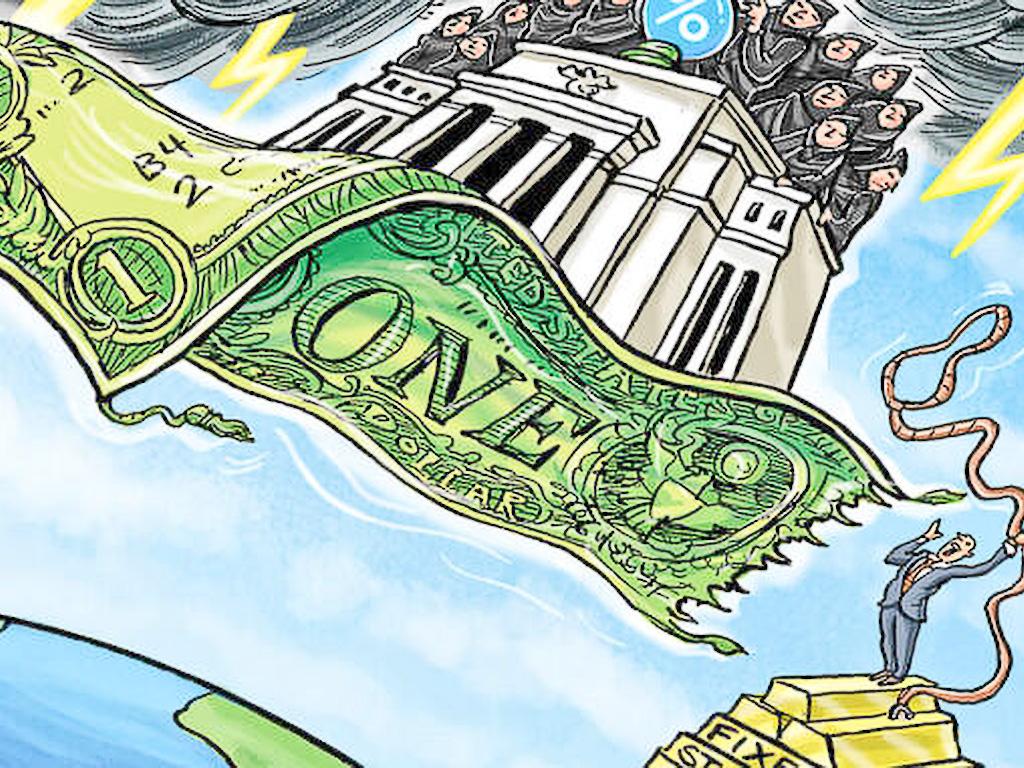




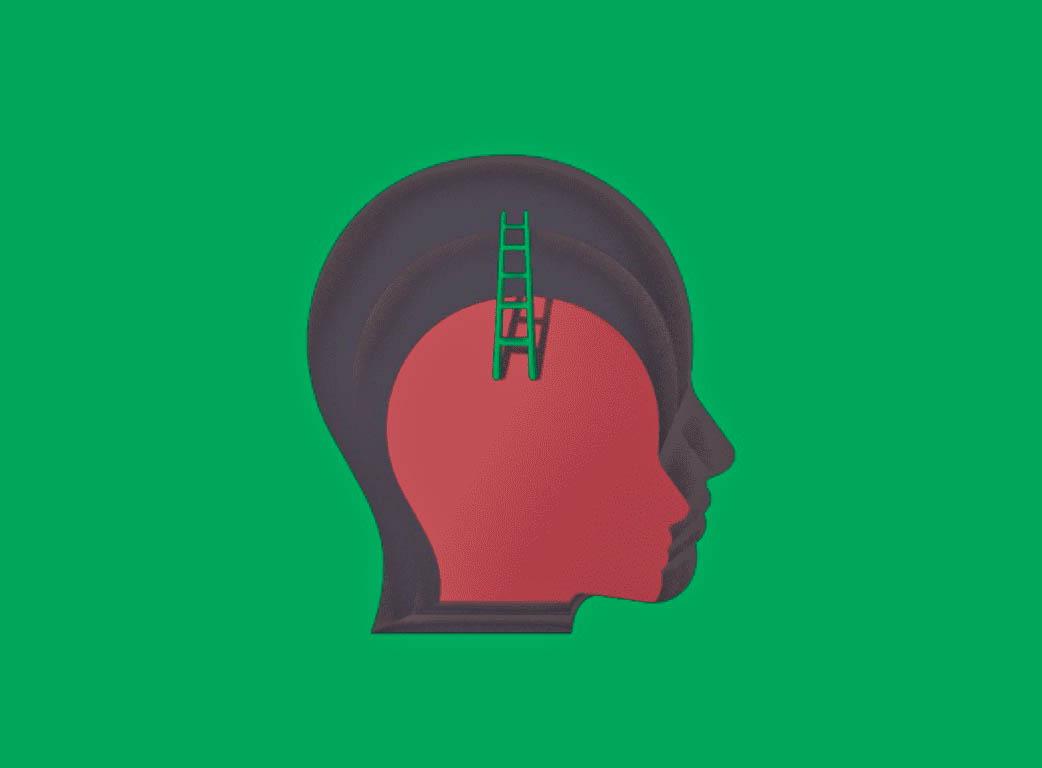









 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire