Trump démonte les mythes du commerce, y compris les siens
IPS 02.07.2025 Jomo Kwame Sundaram Traduit par: Jpic-jp.orgLes droits de douane du président Donald Trump ont mis à nu l’idéologie néolibérale du commerce et affaibli les groupes de pression corporatifs qui agissent au nom du libre-échange. Mais sa rhétorique a également révélé les failles de sa propre stratégie économique.
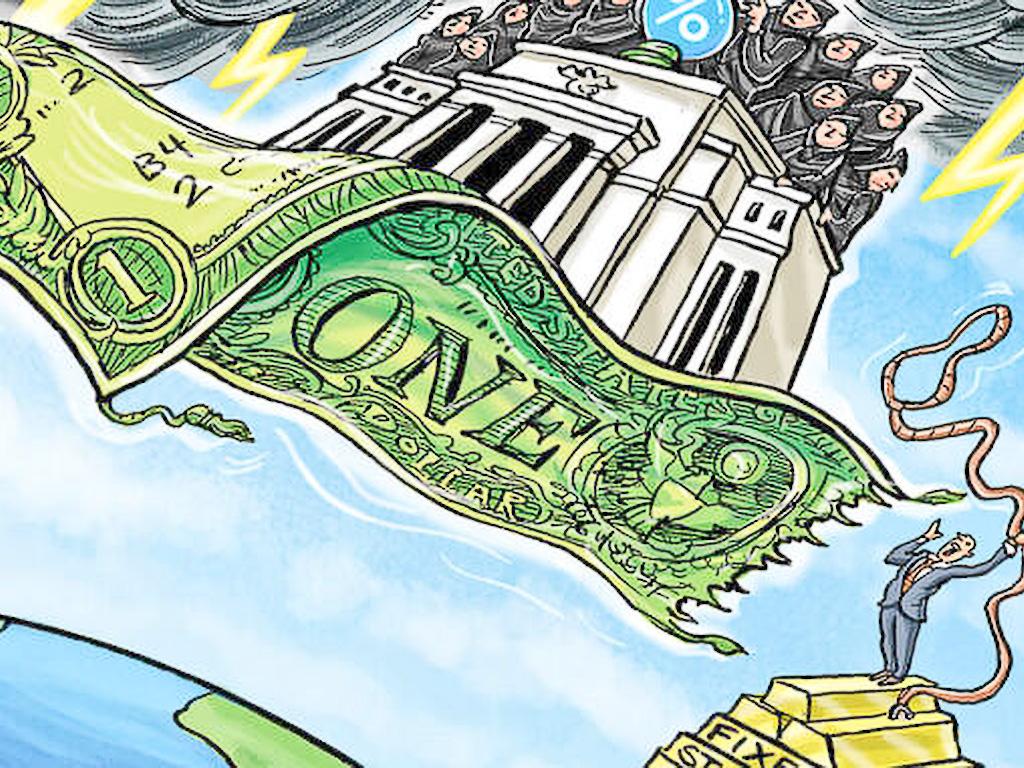
Sans aucun doute, il n’y a jamais eu d’ère de véritable libre-échange. Le commerce international a toujours été partiellement et inégalement libre, et dans la plupart des cas, réglementé. La plupart des prétendus partisans du néolibéralisme n’ont jamais promu le libre-échange de façon cohérente, indépendamment des circonstances, mais uniquement lorsqu’il semblait servir leurs intérêts nationaux et corporatifs, par exemple à travers des échanges inégaux.
Les droits de douane de Trump visent à relancer les emplois du secteur manufacturier que les États-Unis ont perdus à cause des importations meilleur marché. Mais les emplois perdus à cause de l’automatisation seront presque impossibles à récupérer. Pire encore, ses tarifs imposeront une charge fiscale régressive aux consommateurs américains.
Le libre-échange ne favorise ni l’investissement sélectif ni la promotion technologique. Son prédécesseur, Joe Biden, a tenté de promouvoir de nouvelles industries — souvent à un coût élevé — grâce à la Loi de réduction de l’inflation, la Loi sur les puces et la science, et d’autres mesures de politique industrielle.
Cependant, ces efforts ont été minés par l’insistance de Trump à répudier les initiatives des administrations précédentes et à réduire les dépenses publiques non militaires, même lorsqu’elles servaient ses prétendus objectifs stratégiques.
Avec les droits de douane comme principale arme politique dans son approche transactionnelle et intimidante de la négociation exclusivement bilatérale, les ambitions de réindustrialisation de Trump ne peuvent connaître qu’un succès partiel.
Son refus de négocier collectivement renforce l’avantage des États-Unis dans ce type de négociations asymétriques. D’autres, désireux de gagner ses faveurs, ont déjà accordé des concessions excessives, dépassant même les attentes de Washington ! Ainsi, le sort des plus défavorisés ne fait que s’aggraver, générant un ressentiment et un antagonisme généralisés. Mais il est peu probable que les plus faibles obtiennent des bénéfices tangibles, sauf quelques concessions minières.
La fin de Bretton Woods
Dans les années 1960, le président français Charles de Gaulle se plaignait que l’Accord de Bretton Woods (BWA) de 1944 avait conféré aux États-Unis un « privilège exorbitant ». Le prix de l’once d’or avait été fixé à 35 dollars.
Cette parité permit aux États-Unis d’obtenir des crédits bon marché de la part de ceux qui avaient besoin de dollars. La vente d’obligations du Trésor américain au reste du monde lui permit ainsi de combler à la fois son déficit commercial et son déficit budgétaire.
La pression sur le dollar augmenta au cours des années 1960, notamment avec la forte hausse des dépenses liées à la guerre du Viêt Nam. La France mena alors d’autres pays à exiger de l’or plutôt que de conserver des dollars.
En août 1971, le président Richard Nixon répudia unilatéralement l’obligation des États-Unis, prévue par le BWA, d’échanger l’or au prix promis en dollars. Mais cela ne mit pas fin au privilège exorbitant américain.
Les États-Unis permirent à l’OPEP, dirigée par l’Arabie saoudite, d’augmenter le prix du pétrole, à condition que les paiements se fassent en dollars. Cette hausse des prix du pétrole représenta également un revers pour leurs rivaux industriels émergents d’Europe et du Japon.
Depuis 1971, l’acceptation du dollar américain repose sur la croyance qu’il restera la monnaie de réserve internationale. Ainsi, le privilège exorbitant est devenu une question de foi.
Ironiquement, tandis que les eurodollars avaient sapé le BWA, les pétrodollars sauvèrent le statut du dollar comme monnaie de réserve et consolidèrent son privilège exorbitant, faisant du pétrole le « nouvel or ».
Les mythes du commerce néolibéral
Un demi-siècle de rhétorique néolibérale a soutenu que la « libéralisation du commerce » profitait à tous : tel est son principal mythe. Bien que cela n’ait même pas été vrai dans le Nord global, cela n’a pas empêché les experts en politique économique de défendre les accords de libre-échange avec les États-Unis comme solution aux tarifs de Trump.
Mais même le mahaguru (grand maître) du commerce, l’Indo-Américain Jagdish Bhagwati, insiste sur le fait qu’un accord commercial multilatéral équitable seul peut bénéficier à tous. Il dénonce les accords bilatéraux, régionaux et plurilatéraux comme des termites qui les minent.
Les simulations commerciales basées sur le modèle d’équilibre général calculable (CGE), très populaires, supposent le plein emploi, le commerce et les équilibres fiscaux inchangés.
Ces estimations des gains du libre-échange sont trompeuses, car leurs méthodologies ignorent souvent les effets problématiques majeurs de la libéralisation, tels que la perte de production et d’emplois ainsi que les déséquilibres commerciaux et budgétaires.
Sans surprise, les études coûts-bénéfices réalisées par la Banque mondiale et d’autres organismes ont projeté des pertes nettes pour la majorité du Sud global à partir du cycle de Doha de 2001 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Récits trompeurs
L’annonce par Trump du « choc et effroi » du Jour de la Libération, le 2 avril, a soumis une grande partie du monde d’un seul coup. Comme s’en est vanté le président, des dizaines de gouvernements se sont empressés de « lui lécher les bottes » ou pire !
Cependant, les priorités de Trump — notamment ses baisses d’impôts proposées, l’évolution de l’économie politique mondiale et la diversité des intérêts américains — éroderont le soutien public à son programme.
La narration politique de Trump est ouvertement incohérente et contradictoire. The Financial Times a souligné : « Le président américain veut protéger l’industrie nationale tout en maintenant le dollar comme monnaie de réserve ».
Méprisant volontairement la sagesse conventionnelle, sa rhétorique patriotique et son style auto satisfait séduisent ses partisans avec des preuves choisies et des demi-vérités.
Même si les droits de douane de Trump échouent selon leurs propres termes, il pourra encore prétendre avoir tenté de rendre sa grandeur à l’Amérique. Il continuera à blâmer l’opposition interne et externe afin de consolider le soutien de sa base patriotique, celle qui se rallie au mouvement MAGA : Make America Great Again.
Jomo Kwame Sundaram a été professeur d’économie, secrétaire général adjoint de l’ONU pour le développement économique et lauréat pour sa pensée économique sans frontières.)
Voir, Trump desmonta los mitos comerciales de sus rivales (y los propios)
Ilustración: Cortesía de ElNuevoSistemaMundo





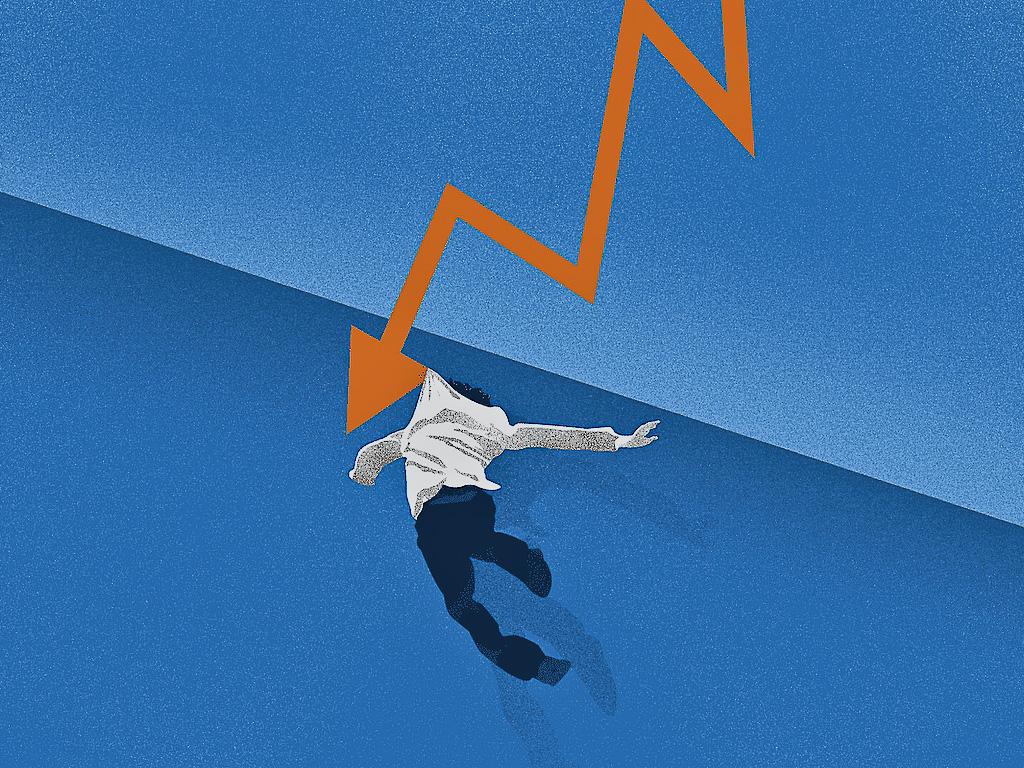





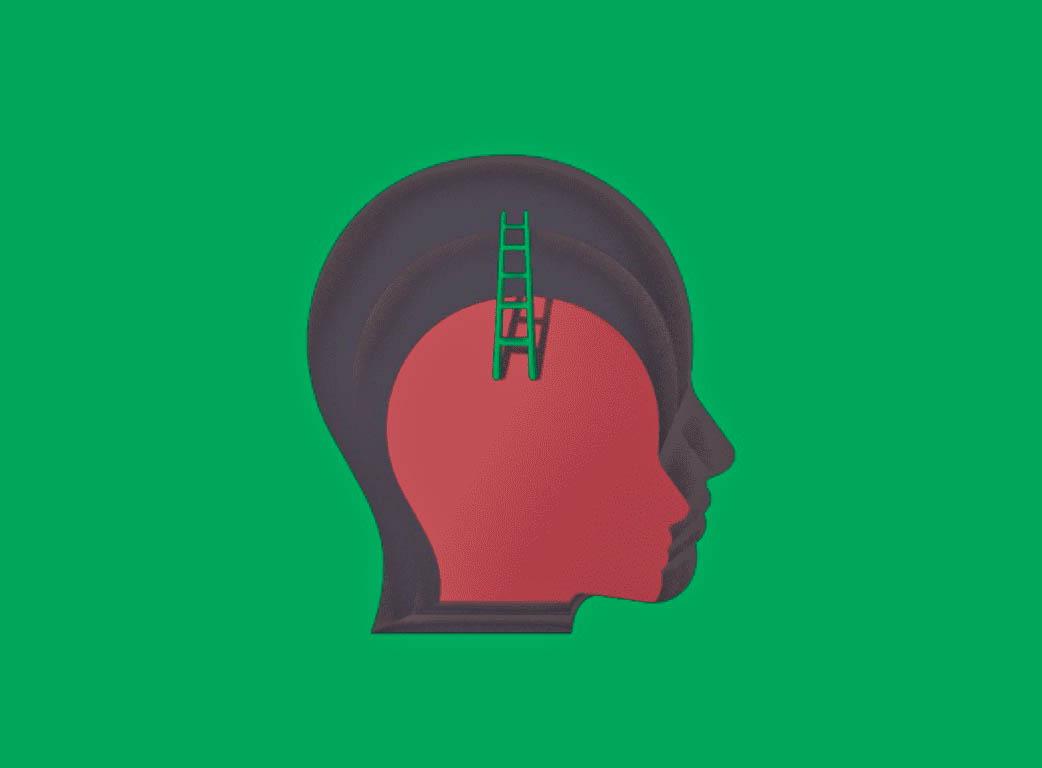









 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire