Syrie-Liban : les Druzes face à un tournant historique
RTF 18.07.2025 Paul Khalifeh Traduit par: Jpic-jp.orgDes centaines de personnes ont été tuées depuis dimanche 13 juillet dans les violences qui opposent à Soueïda, ville du sud de la Syrie à majorité druze, des combattants de cette communauté et les forces gouvernementales syriennes. Le 17 juillet, le président syrien Ahmed al-Charaa a annoncé transférer aux druzes le maintien de la sécurité à Soueïda, mais le conflit s’est complexifié avec l’entrée en jeu de l’armée israélienne aux côtés des groupes armés druzes.

Les raids massifs menés par l’aviation israélienne contre les convois de blindés et d’armes lourdes de l’armée syrienne aux abords et à l’intérieur de Soueïda, et les frappes contre le ministère de la Défense, le QG de l’état-major et d’autres positions militaires à Damas, ont permis de freiner l’avancée des troupes envoyées par le pouvoir damascène.
L’intervention directe de l’aviation israélienne a permis aux groupes armés druzes de reprendre le contrôle d’une partie de Soueïda, chef-lieu de la province éponyme, située à la frontière avec la Jordanie, non loin du Golan.
L’émergence du facteur israélien dans ce conflit inter-syrien n’est pas une surprise. Dans les semaines qui ont suivi la chute du régime de Bachar el-Assad, en décembre 2024, Benyamin Netanyahu et d’autres dirigeants israéliens ont clairement exprimé leur intention de se poser en protecteurs de cette communauté d’un million de personnes, réparties entre la Syrie, le Liban, Israël et une petite minorité en Jordanie.
Au Liban, des siècles de dynasties d’émirs druzes
Les Druzes, considérés comme hérétiques par les groupes radicaux islamistes, sont nés du chiisme ismaélien au début du Xe siècle, sous l’impulsion du calife égyptien fatimide al-Hakem biamrallah (996–1021). Wadi el-Taym, au sud-est du Liban, est le berceau des Druzes qui donneront des siècles plus tard des dynasties d’émirs lesquels gouverneront, au nom des sultans ottomans, de vastes territoires qui s’étendront, à l’époque de Fakhreddine II (1572-1635), jusqu’au nord-ouest de la Syrie, la région de Homs et une partie de la Palestine.
La migration des Druzes vers Soueïda, le Golan et la Galilée aura lieu au XVIe siècle. Dans les années qui suivent la création d’Israël, en 1948, les Druzes acceptent d’intégrer les institutions du nouvel État. C’est la seule communauté arabe qui occupe des postes importants au sein des unités d’élite de l’armée israélienne et des gardes-frontières. Au nombre de 153 000, ils sont essentiellement basés en Galilée.
Leur chef spirituel, cheikh Mouaffak Tarif, qui exerce également un rôle politique de premier plan, est un proche allié de Benyamin Netanyahu.
Mouaffak Tarif : « la bataille de Soueïda est existentielle »
Dès le début des combats à Soueïda, cheikh Tarif a parlé d’une « bataille existentielle pour la communauté druze ». Des sources proches du dignitaire cité par le Haaretz indiquent qu’il a réclamé une « intervention militaire » contre les troupes syriennes envoyées dans la province du sud de la Syrie.
Le soutien de la communauté druze au gouvernement de Benyamin Netanyahu et plus largement sa loyauté vis-à-vis de l’État d’Israël sont des raisons suffisantes pour expliquer la décision du Premier ministre israélien d’accéder à la requête de Mouaffak Tarif.
Cependant, ce n’est pas la seule explication. Qu’ils soient à Soueïda, au Golan ou au Liban, les Druzes occupent des espaces géographiques situés non loin des frontières nord de l’État hébreu. En se rapprochant de cette communauté, Israël espère compter sur un allié potentiel pour sécuriser son flanc septentrional. C’est l’un des piliers du plan de « remodelage du Proche-Orient » évoqué par Benyamin Netanyahu depuis les grands changements des rapports de force survenus ces deux dernières années. La normalisation des relations avec les pétromonarchies du Golfe est un autre pilier de ce plan.
C’est dans la perspective de se rapprocher des Druzes de Syrie et du Liban qu’Israël a encouragé Mouaffak Tarif à établir des relations avec des dignitaires religieux et des personnalités politiques de cette communauté dans ces deux pays.
Israël tisse des liens avec les Druzes de Syrie et du Liban
En mars dernier, cheikh Tarif a invité une soixantaine de figures spirituelles de Soueïda à visiter le « sanctuaire du prophète Choueib », vénéré par les Druzes, près de Tibériade, en Basse-Galilée. Ce pèlerinage avait été organisé par l’un des trois chefs spirituels suprêmes (cheikhs al-Aql) des Druzes de Soueïda, cheikh Hikmat al-Hijri, en coordination avec Mouaffak Tarif.
Au Liban, Wiam Wahhab, un ancien ministre qui était proche de l’ex-régime syrien et du Hezbollah, prend depuis des mois la défense de cheikh Tarif. Un virement de cap qui a surpris de nombreux observateurs à Beyrouth. L’option de la protection israélienne proposée aux Druzes de Syrie – et par extension du Liban – est loin de faire l’unanimité au sein de la communauté.
En Syrie, deux des trois principales figures religieuses, les cheikhs al-Aql Youssef Jarbouh et Hammoud al-Hannawi, rejettent toute tentation séparatiste et plaident pour une solution négociée « à l’intérieur des institutions de l’État syrien ». Ils sont toutefois en perte de vitesse sur le plan populaire en raison des exactions menées par les troupes gouvernementales et des soupçons qui entourent le nouveau pouvoir syrien sur ses intentions réelles vis-à-vis des minorités. Des soupçons alimentés par les souffrances infligées à la petite communauté druze d’Idleb (16 000 personnes), qui avait pratiquement été contrainte de renier ses croyances.
Liban-Syrie, même clivage chez les Druzes
Le troisième cheikh al-Aql Hikmat al-Hijri a, lui, le vent en poupe. Tenant d’une ligne dure envers le pouvoir damascène qu’il a qualifié de « radical » en mars dernier, il est partisan d’une large autonomie et réclame une intervention étrangère pour « protéger les Druzes du génocide qu’ils subissent ».
Cheikh al-Hijri a dénoncé tout accord de cessez-le-feu et appelé les jeunes de la communauté à prendre les armes pour repousser les troupes gouvernementales de Soueïda. Ce même clivage est présent chez les Druzes du Liban. Le chef historique de la communauté, Walid Joumblatt, est résolument favorable à une solution négociée avec Damas et rejette toute forme de séparatisme et de partition de la Syrie.
M. Joumblatt, premier homme politique libanais à se rendre à Damas pour rencontrer le président de la transition, Ahmed al-Charaa, le 22 décembre, multiplie les mises en garde contre « la tentation israélienne » et dénonce ce qu’il appelle le « piège israélien ». Le cheikh al-Aql du Liban, Sami Abou el-Mouna est proche des thèses de Walid Joumblatt. Cependant, les positions jugées conciliantes des deux personnalités suscitent un fort mécontentement chez une frange de plus en plus importante de la population et de l’institution religieuse.
Mercredi, des centaines de jeunes druzes ont bloqué la route Beyrouth-Damas dans le fief montagneux de la communauté pour protester contre « les massacres perpétrés à Soueïda » contre leurs coreligionnaires.
Si la dynamique séparatiste, alimentée par l’interventionnisme israélien, l’emporte chez les Druzes de Syrie, la contagion vers le Liban sera difficile à stopper. Dans le même temps, si la rébellion de Soueïda est noyée dans le sang, le ressentiment gagnera les Druzes de toute la région.
Les deux scénarios seront dangereux et insupportables pour le pays du Cèdre.
Voir, Syrie-Liban : les Druzes face à un tournant historique
Photo. Manifestation de membres de la communauté druze à la frontière avec Israël, sur le plateau du Golan, le 16 juillet 2025. © Leo Correa / AP










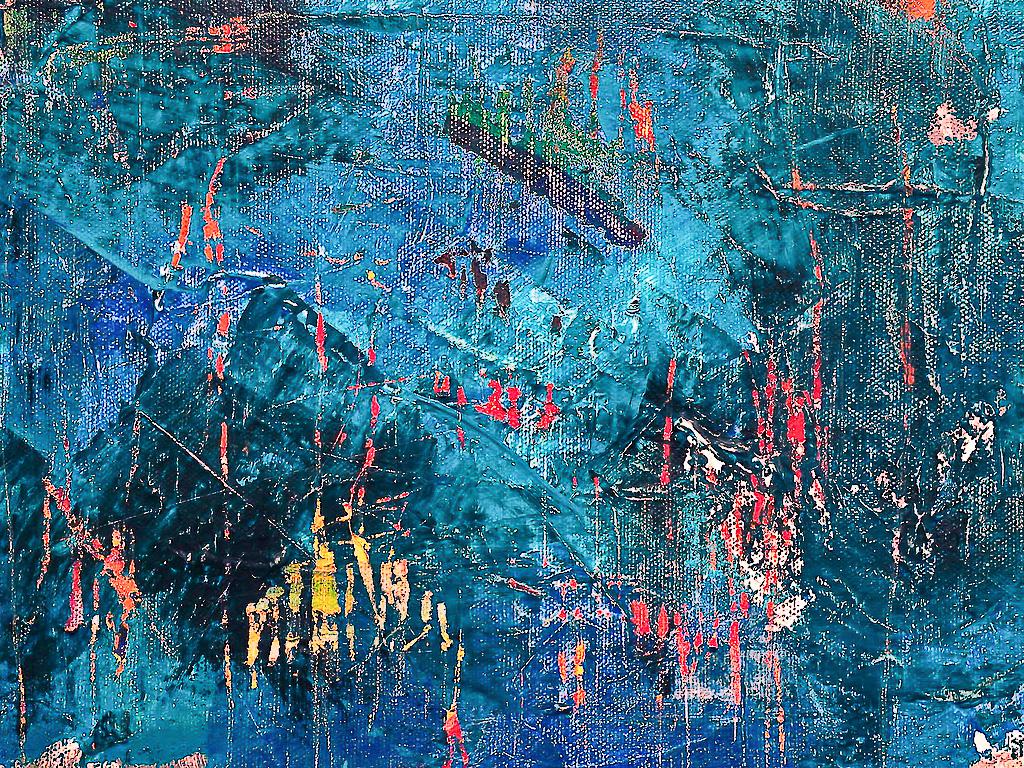


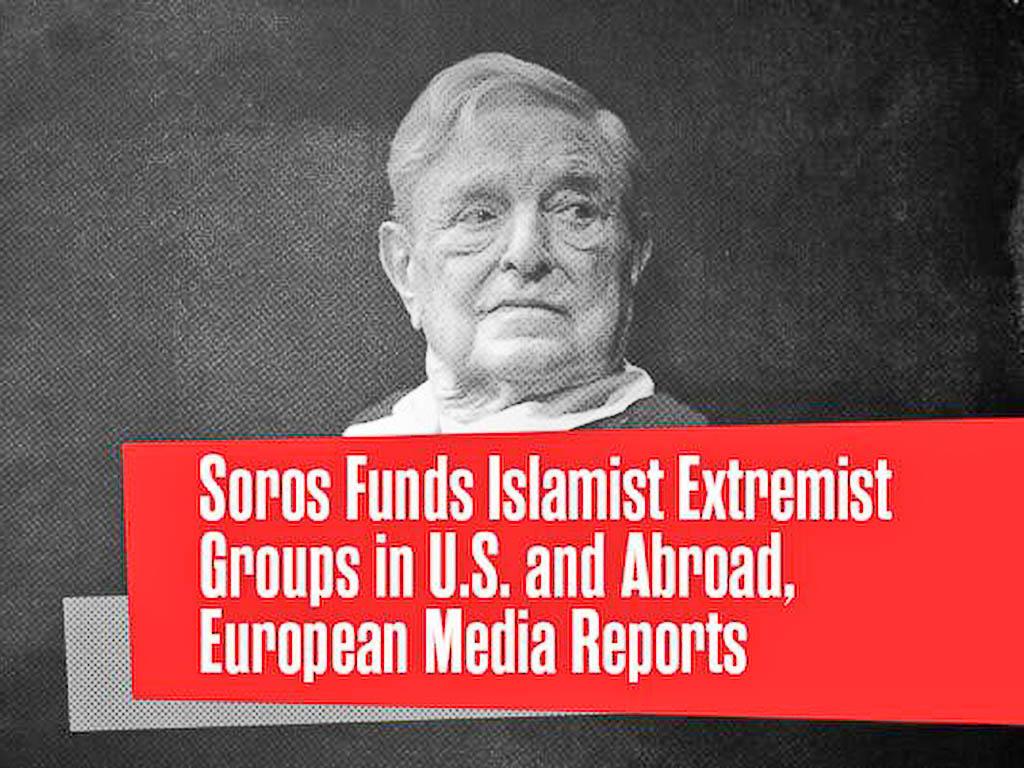







 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire