Un défi nécessaire et un signe d’espoir
Butembo 22.09.2025 Jpic-jp.org Traduit par: Jpic-jp.orgDans un monde qui semble s’orienter de manière préoccupante vers un réarmement généralisé, le choix de créer une institution publique dédiée à la promotion de la paix n’est pas seulement souhaitable ou nécessaire : c’est un signal d’espoir. Alors que certains veulent transformer le ministère de la Défense en ministère de la Guerre, ‘Fratelli Tutti’ nous parle d’un « ministère pour la Paix ».

À une époque marquée par des tensions géopolitiques croissantes, des conflits sanglants et un inquiétant retour à la logique du réarmement, émerge avec force une proposition radicale et audacieuse, mais profondément ancrée dans les principes fondateurs de la République italienne : l’institution d’un ministère pour la Paix. Il ne s’agit pas d’une simple revendication rhétorique, mais d’un défi concret, d’une affirmation politique claire qui cherche à proposer une alternative structurelle à la logique du conflit et de la force.
L’idée, relancée par de nombreuses associations chrétiennes et pacifistes, s’inspire profondément de l’encyclique du pape François Fratelli Tutti et a été accueillie par la Fondation Vaticane « Fratelli Tutti, pour la fraternité et l’amitié sociale », instituée par le pape lui-même le 8 décembre 2021, chargée de promouvoir des initiatives basées sur les principes de l’encyclique éponyme. Le père Francesco Occhetta, secrétaire général de la Fondation, rappelle que la création d’un tel ministère n’est pas un geste symbolique, mais un engagement à promouvoir un mode de vie différent, fondé sur une justice réparatrice plutôt que vindicative, sur la médiation des conflits et le dialogue. C’est l’expression d’une volonté collective qui s’oppose à la peur et à la vengeance qui animent les intérêts politiques des « grands et des puissants », et qui se fait porte-parole du peuple, qui ne veut pas la guerre.
Le projet, présenté à Rome lors d’un événement rassemblant des voix autorisées du monde académique, religieux et du tiers secteur, vise à redéfinir le concept même de paix, qui ne peut être un pacifisme générique, mais un engagement concret, institutionnel et structurel.
La proposition trouve un fondement solide non pas dans une idéologie abstraite, mais au cœur de la Constitution italienne, dont l’article 11 stipule : « L’Italie répudie la guerre comme instrument d’offense à la liberté des autres peuples et comme moyen de résolution des conflits internationaux ; elle consent, dans des conditions d’égalité avec les autres États, aux limitations de souveraineté nécessaires à un ordre garantissant la paix et la justice entre les Nations ; elle promeut et favorise les organisations internationales poursuivant ce but ».
- Il ne s’agit donc pas seulement d’une répudiation formelle de la guerre pour un principe éthique, mais d’une norme juridique interdisant l’usage de la force militaire pour l’agression ou la résolution de conflits.
- Cela impose une mission active : créer les conditions nécessaires pour éliminer les conflits et instaurer un ordre international fondé sur la justice et sur des relations pacifiques entre les peuples, en promouvant activement les institutions et organisations internationales œuvrant pour la paix et la justice.
- Cela implique l’acceptation de limitations de souveraineté, car la paix ne peut être garantie dans l’isolement, mais nécessite la participation à un ordre international basé sur la coopération et la justice, même au prix d’une cession partielle de souveraineté nationale.
Un ministère de la Paix s’insérerait parfaitement dans ce cadre et deviendrait l’instrument institutionnel pour concrétiser la vocation « à la paix », en coordonnant les politiques publiques et en fournissant au Parlement les outils pour contrôler leur réalisation effective.
Le principe de la répudiation de la guerre et de la promotion de la paix n’est pas exclusif à la Constitution italienne. D’autres nations, souvent marquées par des conflits historiques, ont inscrit des principes similaires dans leurs textes fondamentaux :
- Le Japon, dont l’article 9 de la Constitution stipule : « Le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation et à la menace ou à l’usage de la force comme moyen de résoudre les conflits internationaux. Les forces terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que tout autre potentiel de guerre, ne seront jamais maintenues ». C’est sans doute l’exemple le plus radical de pacifisme constitutionnel, bien que son interprétation ait fait l’objet de débats.
- La République fédérale d’Allemagne, dont la Loi fondamentale affirme : « La Fédération peut, pour la sauvegarde de la paix, adhérer à un système de sécurité collective impliquant une limitation de sa souveraineté » (art. 24) et « Les actions pouvant troubler la coexistence pacifique entre les peuples et entreprises dans l’intention de préparer une guerre d’agression sont inconstitutionnelles » (art. 26).
Cette Loi fondamentale, rédigée après la Seconde Guerre mondiale, interdit spécifiquement la guerre d’agression et encourage la participation à des systèmes de sécurité collective visant à maintenir la paix.
- La Constitution norvégienne, art. 111 : « Le Roi et le Gouvernement ne peuvent déclarer la guerre ni entrer dans une union ou alliance militaire sans le consentement du Parlement ». Sans répudier explicitement la guerre, cet article impose une forte limitation, reflétant un principe de prudence et de non-belligérance.
- La Constitution de la Fédération de Russie, art. 79 : « La Fédération de Russie n’accepte pas de rejoindre des organisations interétatiques dont les objectifs sont contraires aux intérêts de la Fédération de Russie, y compris la menace à l’indépendance et à l’intégrité territoriale ». Cet article appelle au respect de la souveraineté et à l’ouverture à la coopération internationale, tout en mettant l’accent sur la défense des intérêts nationaux.
Ces exemples montrent que le principe d’un « pacifisme constitutionnel » n’est pas isolé, mais résulte d’un choix conscient de plusieurs nations, qui, après des expériences historiques dramatiques, souhaitent ancrer leur politique étrangère dans des valeurs de paix, de coopération et de justice internationale.
Cependant, les principes opérationnels de la politique étrangère russe, comme le montre la guerre en Ukraine, et d’autres pays, sont souvent en contradiction avec ces principes de paix. De plus, comme en Italie, la « volonté institutionnelle de paix » est fragmentée : la Présidence du Conseil s’occupe du service civil, le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, le ministère de la Justice des parcours de justice réparatrice, et le ministère de l’Éducation de l’éducation à la non-violence. Cette fragmentation, même guidée par la bonne volonté, rend difficile une approche holistique et intégrée.
De plus, la véritable paix, comme le rappelle Occhetta, se construit par le désarmement, entendu non seulement comme réduction des armes, mais comme un désarmement plus profond des esprits, du langage et de la culture de la peur. Cette approche, centrée sur la dignité humaine et la force de la non-violence, représente un véritable « nouvel humanisme institutionnel ».
Un ministère de la Paix unifierait ces efforts, promouvant une vision cohérente qui ne se limite pas à l’absence de guerre, mais englobe la gestion des conflits, la création de conditions de justice et la prévention des hostilités.
La création de ce ministère offrirait également une opportunité unique de valoriser et de coordonner l’énorme engagement politique et social déjà en marche dans chaque pays par des milliers d’organisations. Dans une perspective de subsidiarité, l’État pourrait soutenir et promouvoir cette « vitalité sociale », en dotant de ressources stables les projets de pacification et en rendant transparentes les activités qui y sont liées. La paix n’est pas un événement fortuit, mais le résultat d’un travail constant et organisé.
Le chemin vers la paix exige un engagement culturel et générationnel. Les jeunes sont déjà profondément impliqués dans les drames de notre temps, de la guerre aux défis climatiques. Il est essentiel de les soutenir en promouvant des moments de fraternité et des échanges internationaux, accompagnés de la construction de conditions de vie et de travail dignes et justes. La culture de la paix doit être enracinée et s’épanouir dans les nouvelles générations, qui représentent l’espoir d’un avenir différent.
Un ministère pour la Paix, s’il existait dans certains pays, serait un exemple concret et tangible de démocratie engagée, à offrir à la communauté internationale comme témoignage qu’une autre voie est possible. Un exemple de cette paix « désarmée et désarmante » dont nous avons un besoin urgent et qui, comme le souhaite le pape Léon XIV, peut devenir notre boussole dans un monde à la dérive. Cette proposition n’est pas seulement une réponse aux crises actuelles, mais un investissement à long terme pour construire un futur où la justice, le dialogue et la non-violence seront les véritables piliers des relations humaines et internationales.
Voir, Un ministero della Pace, alternativa concreta alla logica della forza et La sfida di un ministero della pace







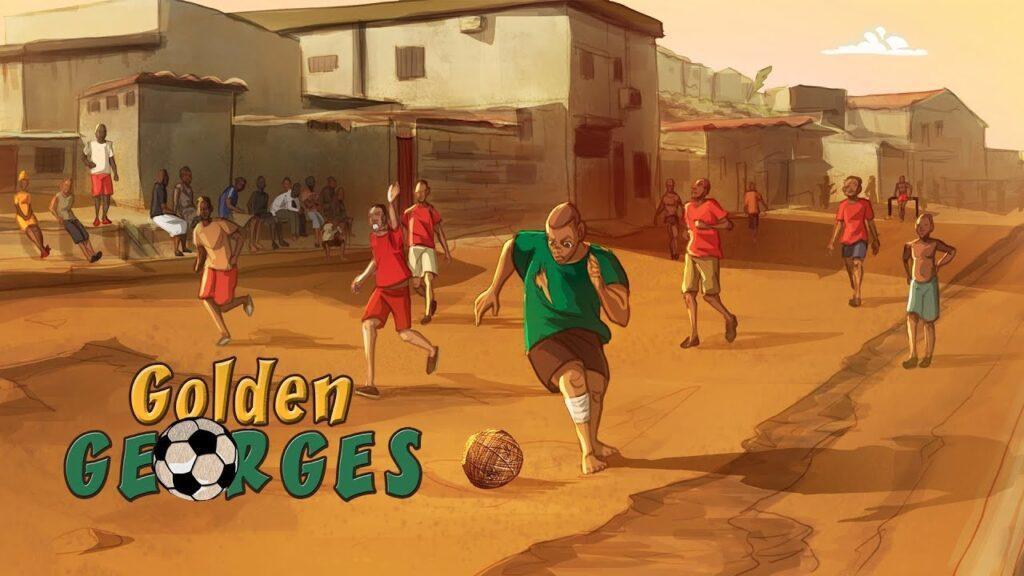













 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire