L’Afrique vise à devenir une puissance mondiale verte
Rivista Nigrizia 11.09.2025 Nigrizia Traduit par: Jpic-jp.orgLe deuxième sommet de l’Union africaine sur le climat s’est conclu en Éthiopie. Le continent se propose de mobiliser 50 milliards de dollars par an pour des solutions climatiques et 100 milliards supplémentaires pour la production d’énergie verte. Voir L’Africa punta a diventare una potenza globale green

Le deuxième Sommet de l’Union africaine sur le climat (ACS2) s’est achevé à Addis-Abeba, en Éthiopie. Cette rencontre préparatoire se tenait en vue de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP30), prévue à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre. Les pays africains entendent y participer avec des programmes, des revendications, des propositions et des priorités communes.
Du document final du sommet, appelé Déclaration d’Addis-Abeba, se dégagent trois grands axes :
- Accélérer le développement des énergies renouvelables ;
- Former une coalition de pays détenant des minerais essentiels afin de garantir une juste valeur dans les chaînes d’approvisionnement mondiales ;
- Protéger le patrimoine naturel par des partenariats pour le reboisement et la restauration des écosystèmes.
Objectifs
Transformer le continent en une puissance industrielle verte dans le domaine des énergies renouvelables et des solutions climatiques, tout en réclamant de la communauté internationale des financements équitables et garantis.
En particulier, la Déclaration demande « un soutien renforcé et durable pour élargir la mise en œuvre des initiatives climatiques dirigées par l’Afrique, telles que l’African Union Great Green Wall Initiative, l’African Forest Landscape Restoration Initiative, l’Ethiopian Green Legacy Initiative, entre autres ».
« Notre vision est claire. Nous nous engageons à bâtir un continent prospère, résilient et vert », a déclaré le président éthiopien Taye Atske Selassie. « Il est injuste que plus de 600 millions d’Africains vivent encore sans accès à l’électricité. Notre action climatique doit commencer par des investissements massifs dans les énergies renouvelables et un appel à la justice climatique ».
« Les demandes africaines de financement climatique ne sont pas des appels à la charité. Ce sont des appels à l’équité, à la justice et à la responsabilité mondiale partagée », a ajouté le commissaire de l’UA pour les Affaires politiques, la Paix et la Sécurité, Bankole Adeoye. « L’Afrique n’est pas un problème à résoudre. L’Afrique est une solution à soutenir ».
Ce qui est demandé
Les dirigeants africains soulignent que le continent a besoin de plus de 3 000 milliards de dollars pour atteindre ses objectifs climatiques d’ici 2030, mais n’a reçu que 30 milliards entre 2021 et 2022. Dans l’attente de financements extérieurs qui arrivent au compte-gouttes, l’Afrique ambitionne de mobiliser 50 milliards de dollars par an pour des solutions de résilience face à la crise climatique grâce à deux nouveaux instruments financiers internes : l’Africa Climate Innovation Compact et l’African Climate Facility.
Les leaders africains ont également signé un accord entre bailleurs de fonds du développement africain et banques commerciales afin de mobiliser 100 milliards de dollars supplémentaires pour investir dans la production d’énergie verte.
L’Afrique contribue à moins de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais elle est parmi les régions les plus vulnérables aux impacts de la crise climatique. Le continent perd chaque année entre 2 et 5 % de son PIB en raison des catastrophes climatiques. Selon l’Union africaine, plus de 100 millions de personnes sont actuellement menacées par les sécheresses, inondations ou cyclones, tandis que les conflits liés à l’accaparement des ressources en eau et des terres ne cessent d’augmenter. Le changement climatique en Afrique : il coûte entre 5 et 15 % du PIB par habitant.
La grande illusion de la transition énergétique
Les données d’une vaste étude internationale intitulée Qui finance l’expansion des combustibles fossiles en Afrique ?, menée par Urgewald, Stop Eacop, Oilwatch Africa, Africa Coal Network et 33 autres ONG africaines engagées contre les violations des droits humains et les atteintes à l’environnement, sont sans appel : le secteur de l’énergie polluante est en pleine expansion sur le continent, piloté par des investisseurs étrangers et financé par des banques commerciales, avec en tête Total, Eni et Sonatrach. Pour les Africains, les bénéfices sont nuls ; pour la planète, les dégâts sont énormes.
Le rapport met en lumière les hypocrisies, les proclamations et les politiques masquant une réalité : la course aux combustibles fossiles en Afrique est bel et bien lancée. Elle implique 200 entreprises explorant ou développant de nouvelles réserves de combustibles fossiles et de nouvelles infrastructures, telles que terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL), gazoducs ou centrales électriques à gaz et à charbon.
Des compagnies pétrolières, gazières et charbonnières – soutenues par des banques, investisseurs et assureurs – opèrent dans 48 des 54 pays africains, y compris dans des zones naturelles protégées ou à proximité de sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
Le rapport révèle que 89 % des nouvelles capacités de GNL en Afrique sont destinées à l’exportation (principalement vers l’Europe et l’Asie) et que des investisseurs internationaux détiennent plus de 109 milliards de dollars dans les entreprises qui pilotent l’expansion des combustibles fossiles en Afrique : « des projets d’énergie sale totalement incompatibles avec les objectifs climatiques de Paris et la limite de 1,5 °C », affirme Omar Elmawi, de la campagne Stop Eacop.
Depuis 2017, de nouvelles explorations pétrolières et gazières ont été autorisées sur 886 000 km², une superficie plus vaste que la France et l’Italie réunies. Sur les 45 pays africains où l’industrie du pétrole et du gaz prospecte, 18 sont appelés « pays de frontière », tels que la Namibie, l’Ouganda ou la Somalie, car ils produisent peu ou pas encore de pétrole ou de gaz.
Les données de Rystad Energy indiquent que les dépenses d’exploration pétrolière et gazière en Afrique sont passées de 3,4 milliards de dollars en 2020 à 5,1 milliards en 2022. Les entreprises africaines ne représentent pas un tiers de cette somme. La majorité de l’exploration est réalisée et financée par des sociétés étrangères.
Les sociétés impliquées
En première position figure la française TotalEnergies, qui tire 25 % de sa production d’hydrocarbures d’Afrique et vise à l’augmenter jusqu’à 2,27 milliards de barils. L’extraction et la combustion de ces ressources équivaudraient à trois années d’émissions annuelles de gaz à effet de serre de la France.
Viennent ensuite la société publique algérienne Sonatrach (1,75 milliard de barils) et l’italienne Eni (1,32 milliard de barils). Globalement, les compagnies pétrolières et gazières veulent ajouter au moins 15,8 milliards de barils à leur portefeuille de production en Afrique d’ici 2030, soit l’équivalent de 8 gigatonnes de CO₂eq libérées dans l’atmosphère. Cela représente plus du double des émissions annuelles de tous les pays de l’Union européenne.
Les infrastructures (gazoducs et terminaux GNL) sont coûteuses : celles de TotalEnergies dépasseront 5 milliards de dollars pour fonctionner au moins 20 ans ; le projet Rovuma GNL d’ExxonMobil et d’Eni au Mozambique ainsi que le projet Tanzanie GNL d’Equinor sont estimés chacun à 30 milliards de dollars, pour une durée d’exploitation de 30 ans.
La mort des énergies renouvelables
Ces projets généreront des milliards de dollars mais condamnent les espoirs d’un véritable passage aux énergies renouvelables. « Atteindre l’accès universel à l’énergie moderne en Afrique d’ici 2030 nécessiterait 25 milliards de dollars par an », estime l’Agence internationale de l’énergie, un montant comparable au coût d’un seul grand projet GNL.
« La dépendance de l’Europe aux combustibles fossiles est l’un des principaux moteurs des nouveaux projets de GNL en Afrique. La ruée vers le pétrole et le gaz africains n’a rien à voir avec l’amélioration de l’accès à l’énergie pour les Africains », affirme Anabela Lemos, directrice de Justiça Ambiental.
L’industrie charbonnière continue également à s’étendre sur le continent. Mines et infrastructures de transport sont déjà planifiées ou en cours de développement dans 11 pays africains. Au Zimbabwe, où 47 % de la population n’a pas accès à l’électricité, un vaste programme d’exploitation de combustibles fossiles est prévu. Actuellement, 70 nouvelles mines de charbon sont en activité dans 9 pays : principalement en Afrique du Sud (49), au Zimbabwe (6), au Botswana (5) et au Mozambique (4). Et cela alors même que l’Afrique dispose d’un immense potentiel en énergies renouvelables.
Selon le rapport, en juillet 2022, plus de 5 000 investisseurs institutionnels détenaient pour 109 milliards de dollars d’actions et d’obligations dans des entreprises développant de nouveaux projets fossiles en Afrique. Le plus grand investisseur institutionnel est BlackRock (plus de 12 milliards), suivi de Vanguard (8,4 milliards) et du Fonds de pension du gouvernement norvégien (3,7 milliards).
Les banques commerciales injectent elles aussi des capitaux : plus de 98 milliards de dollars entre janvier 2019 et juillet 2022. Parmi elles, des banques italiennes comme UniCredit (2,163 milliards) et Intesa Sanpaolo (1,491 milliard), qui soutiennent les projets pétroliers et gaziers d’Eni. En 2021, Eni était la deuxième multinationale extractive en Afrique, avec 59 % de sa production mondiale issue du continent, et prévoit encore une hausse de 1,32 milliard de barils. Elle est présente dans 14 pays africains, dont l’Égypte, le Nigeria, la Libye, l’Algérie, la République du Congo, l’Angola et le Mozambique. C’est précisément au Mozambique, dans les zones les plus riches en gaz, qu’une insurrection armée menée par un mouvement djihadiste sévit depuis 2017. Elle a causé plus de 4 000 morts et 800 000 déplacés, parmi lesquels la religieuse combonienne Maria De Coppi.
Selon le rapport, 71 % du soutien bancaire aux combustibles fossiles en Afrique provient de banques membres de la Net Zero Banking Alliance. « Cette course au gaz africain en réponse à la crise énergétique européenne n’est pas de bon augure », souligne l’étude, « et n’améliorera certainement pas l’accès à l’énergie pour les Africains ». Les profits iront massivement à une élite mondiale, tandis que les communautés locales devront une fois de plus affronter pollution, appauvrissement et violations des droits humains, marques distinctives du développement fossile et charbonnier en Afrique (cf. Antonella Sinopoli in Rivista Nigrizia).










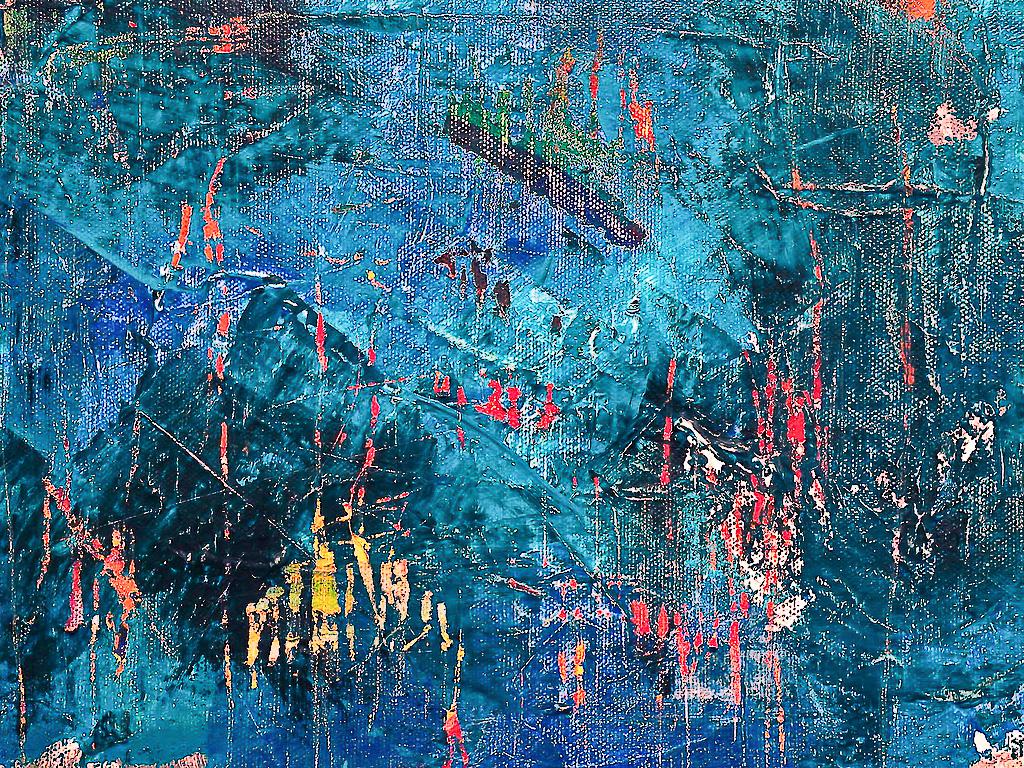


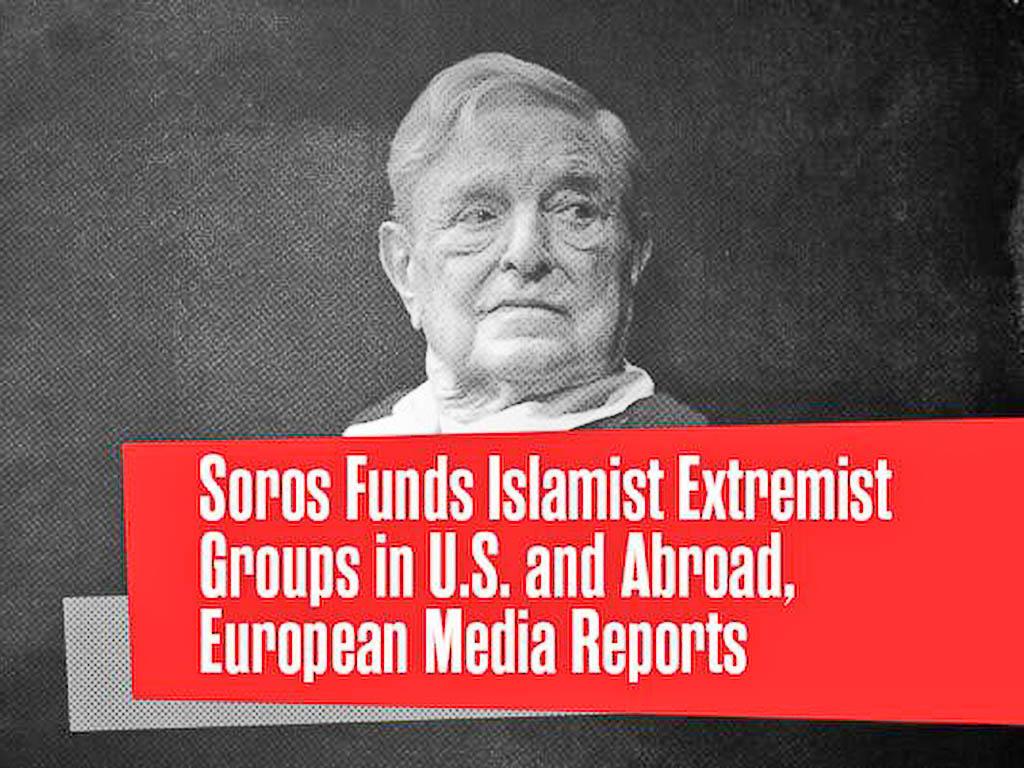







 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire