La société de la performance : toujours produire, ne jamais se rendre
Ethic 01.07.2025 Mariana Toro Nader Traduit par: Jpic-jp.orgEnvoûtée par l’impératif de la performance, la société actuelle commence à en payer le prix. Si pour certains il s’agit de choisir entre la croissance économique et le respect des limites individuelles (et planétaires), il est peut-être possible de trouver un « juste milieu ».
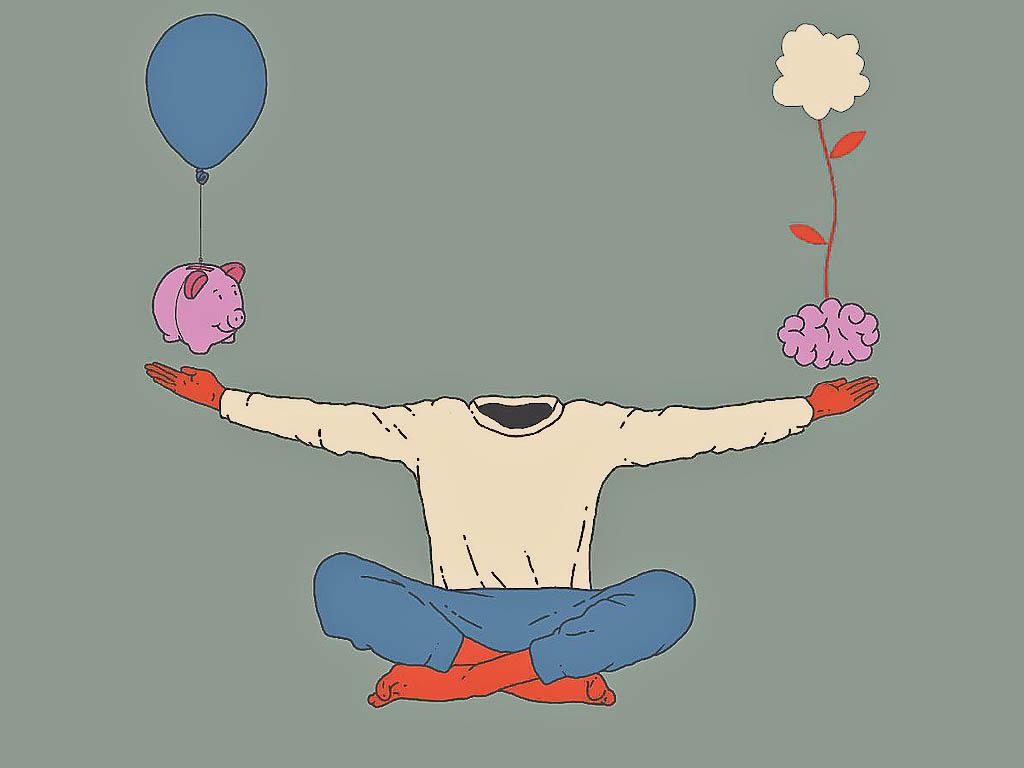
Travailler plus de 80 heures par semaine. Sans rémunération. Tel fut l’appel lancé par Elon Musk, alors à la tête du Département de l’Efficacité Gouvernementale des États-Unis, à des « révolutionnaires au QI très élevé » pour réduire les coûts. Musk lui-même affirme travailler, avec ses employés, 120 heures par semaine. Puisque la semaine compte 168 heures, cela signifierait qu’il ne resterait que 6,8 heures par jour (week-ends inclus) pour dormir, manger, faire les courses, s’occuper des enfants, passer du temps en couple, sortir avec des amis, faire du sport, laver le linge, ranger la maison, payer les factures et retourner au bureau, car l’homme le plus riche du monde considère que le télétravail est « une connerie ».
Au-delà de l’anecdotique, ce qui est grave, c’est que Musk n’est pas le seul magnat à prôner ces mesures pour « faire trembler le système ». Fin 2023, le milliardaire australien Tim Gurner estimait que le taux de chômage devait augmenter de 40 % à 50 % afin d’« infliger de la douleur à l’économie » et de « rappeler aux gens qu’ils travaillent pour leurs employeurs, et non l’inverse ». Ces propos s’inscrivaient dans le contexte de la Grande Démission, phénomène amorcé après la pandémie de Covid-19, où des millions de travailleurs ont démissionné en masse, remettant en question leur mode de vie et de travail.
Un moteur en surchauffe
Notre époque a été affublée de nombreux noms : ère numérique, de l’attention, de la post-vérité ; société liquide, du spectacle, de l’épuisement, du burnout. Mais si l’on devait la résumer en un terme, celui de « société de la performance » serait peut-être le plus approprié. Aujourd’hui, il s’agit d’améliorer la performance économique, académique, mentale, sportive et même sexuelle. Faire beaucoup avec peu. Optimiser. Exploiter le temps, le cerveau, les ressources. L’hyperbole devient la norme.
Des êtres humains hyper-connectés, hyper-informés, hyper-productifs et hyper-optimisés (ou désespérés de ne pas l’être ?-) courent sans relâche, tels des « machines de performance autistes », pour reprendre les mots de Byung-Chul Han.
Pour ce philosophe coréen, la société est passée d’un modèle disciplinaire (pression externe) à une société de la performance (pression interne). L’animal laborans n’a plus besoin de fouet : entrepreneur de lui-même, il s’auto-exploite.
Le homo agitatus, selon Jorge Freire, est voué à l’agitation et à l’hyperactivité : il doit « toujours produire, ne jamais se rendre ». Il pousse son corps et son esprit à l’extrême, jusqu’à la surchauffe. À force de « se donner à fond », le mécanisme s’effondre. C’est le burnout : un excès de puissance interdit de ne pas pouvoir. Vas-y, tu peux, et si tu ne peux pas, c’est que tu ne veux pas. Just do it.
L’interdiction de ne pas pouvoir a conduit à ce que l’on appelle en anglais le bootstrapping: l’idée que chacun doit s’améliorer par la seule force de sa discipline, sans aide extérieure. Ainsi s’installe une culture du surmenage qui associe la pauvreté à un manque d’effort personnel.
C’est dans ce contexte qu’ont fleuri les productivity bros, décrits par Jenny Odell comme « des gens qui font des vidéos pour des gens qui se font des vidéos », promouvant des routines matinales strictes et des astuces d’optimisation du temps. Ces influenceurs s’enrichissent en véhiculant l’idée que l’individu peut être à la fois son propre libérateur et son propre oppresseur. La rhétorique de l’auto-surveillance impose de vérifier sans cesse ses performances à l’aide de tableaux Excel, d’applications, de listes de contrôle, etc. Il y a toujours plus de succès à atteindre, de minutes à optimiser, de corps à sculpter, de biens à acquérir.
Certes, il faut de l’effort pour réaliser ses objectifs. Mais la hustle culture veille à ce que l’écart entre ce que l’on est et ce que l’on pourrait être ne se comble jamais. Cet écart doit rester infranchissable.
L’ostentation de l’agitation
Insomnie, troubles du sommeil, névroses, maladies chroniques, problèmes de santé mentale : le monde dort de moins en moins et de moins en moins bien. 84 % des employés ressentent du stress au travail. L’anxiété et la dépression explosent. Le stress chronique attaque tous les systèmes : il élève la tension artérielle, affaiblit l’immunité, favorise les AVC, nuit à l’attention et accélère le vieillissement.
Dans la société de la performance, il est presque anormal de ne pas être stressé. Le « syndrome de la vie occupée » se généralise : chaque instant est saturé d’obligations. La rareté du temps est devenue objet d’admiration. Michelle Shir-Wise parle de « l’ostentation de l’agitation » : regarde comme je suis débordé, regarde comme je suis compétent. Le stress devient médaille, le burnout trophée.
En anglais, la « société du rendement » se traduit par performance society. L'idée de succès est directement liée au faire. Et, comme si l’auto-exigence ne suffisait pas, des expériences menées par la psychologue sociale Janice Kelly ont démontré que les membres d’une société s’exercent mutuellement une pression, générant une sorte d’« effet de traction ».
Tout cela, en plus, amplifié par la scène ouverte 24h/24 et 7j/7 des réseaux sociaux. On se rend productif et on performe pour un regard extérieur. Le monde extérieur devient un théâtre où l’on enregistre du contenu destiné au monde virtuel.
David Stark, sociologue à Columbia, souligne que le propre de notre époque n’est pas tant la performance que la quantification croissante de tous les domaines de la vie : les entreprises évaluent leurs employés, les marchés scrutent les résultats financiers, les classements mesurent la liberté, la démocratie ou la corruption des pays.
Même le temps libre devient un terrain de performance : il ne suffit plus de rester chez soi en vacances ; il faut voyager plus, lire plus, voir plus, poster plus. L’« économie de l’expérience » remplace le consumérisme matériel par l’ostentation d’expériences exclusives. La jalousie des réseaux sociaux alimente cette course : selon une étude de 2017, deux millennials américains sur cinq choisissent leurs destinations selon leur potentiel instagrammable.
Ironiquement, les activités censées favoriser le bien-être — soins personnels, silence, déconnexion — sont elles aussi devenues des produits de luxe. La lecture même s’est transformée en terrain de compétition : qui a lu le plus de livres, qui est à jour sur les dernières nouveautés ?
Lever le pied
« Les hommes actifs roulent comme des pierres, suivant la bêtise de la mécanique », disait Nietzsche. Quand l’hyperactivité est la norme, les pauses ne servent qu’à recharger pour retravailler. Mais, selon Freire, le contraire de l’agitation n’est pas le repos, mais l’apathie : on surjoue l’agitation pour masquer l’impuissance.
Pour María Novo, nous fuyons notre condition d’êtres limités : la grandeur, la vitesse, l’éloignement sont des tentatives d’échapper à la nature. Une fuite collective en avant.
Lewis Mumford rappelait que ce n’était pas la machine à vapeur mais l’horloge qui a été la véritable machine de l’ère industrielle. Aujourd’hui, les horloges sont partout, chronométrant nos vies. Robert Colville parle de la Grande Accélération, qui dépasse le cadre technologique pour englober les effets environnementaux désastreux.
Face à la crise climatique, certains prônent la décroissance économique pour survivre, tandis que d’autres, citant le rapport Draghi, mettent en garde contre l’impact de la décroissance sur l’État-providence. Mais s’agit-il vraiment d’un jeu à somme nulle ?
Toni Roldán soutient que des sociétés productives peuvent offrir un meilleur équilibre vie-travail, comme le démontre le modèle danois. Pour Carlos Javier González Serrano, l’opposition entre hyperproductivité et État-providence est un faux dilemme. La clé est de bâtir une économie qui ne dévore pas ses propres piliers humains.
Car ni les entreprises ni les gouvernements n’ont intérêt à voir les travailleurs en burnout. Selon Gallup, le désengagement des employés coûte 8 900 milliards de dollars à l’économie mondiale, soit 9 % du PIB global.
Pourquoi, interroge González, réduire le bien-être au seul critère économique ? Et si la clé résidait dans une société plus frugale, où le désir des consommateurs ne serait plus sans cesse stimulé ?
Le développement, rappelait Amartya Sen, doit viser l’amélioration de la qualité de vie. Le psychiatre Carlos Cenalmor souligne qu’un individu heureux est toujours plus productif. Divers rapports, dont le World Happiness Report de l’ONU, démontrent que la qualité des relations humaines est un facteur central de bonheur et de productivité.
Le burnout n’est pas qu’un manque de temps ; il touche au sens de la vie.
Aurea mediocritas
D’où l’émergence de politiques visant à garantir le « droit au temps ». L’adoption de la semaine de quatre jours dans des pays comme l’Allemagne ou le Portugal a prouvé qu’un meilleur équilibre de vie ne réduit pas la productivité, bien au contraire.
Peut-être le juste milieu aristotélicien réside-t-il dans cette idée : lever le pied n’est pas s’arrêter. La lenteur redevient une voie pour renouer avec les rythmes naturels.
Oliver Burkeman le résume ainsi : il se pourrait bien que toutes les tâches ne soient pas vitales, que gagner toujours plus ne soit pas une obligation universelle. Jenny Odell suggère d’expérimenter la médiocrité dans certains aspects de la vie, et de se demander : pour qui cela est-il médiocre, et pourquoi ?
Le burnout n’est pas seulement une question de temps, mais aussi de sens. Peut-être est-ce là la vraie question : qu’est-ce que « vivre sa meilleure vie » ? Il n’y aura sans doute pas de réponse unique.
La vitesse efface les nuances. Aller plus lentement permet de retrouver de l’intention et de rectifier la trajectoire. Le mouvement n’est pas l’inertie : il suppose pauses, sens, direction. Il est possible d’avancer tout en modulant le tempo.
Voir, La sociedad del rendimiento: ¿rendir o rendirse?
Illustration : Óscar Gutiérrez





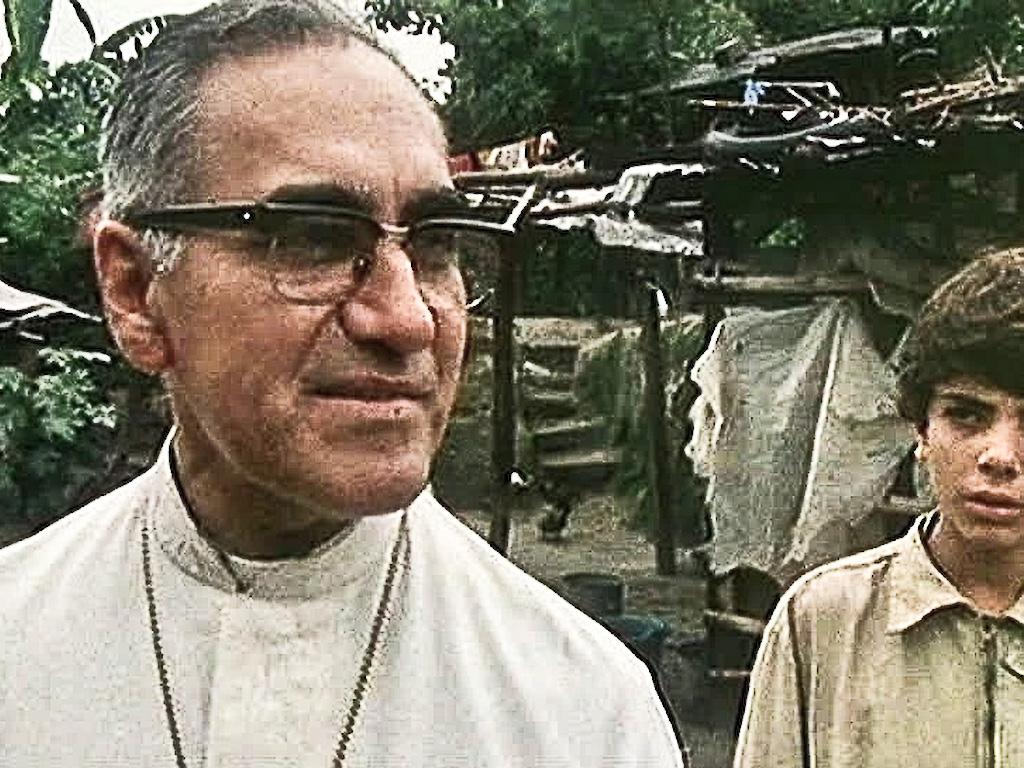

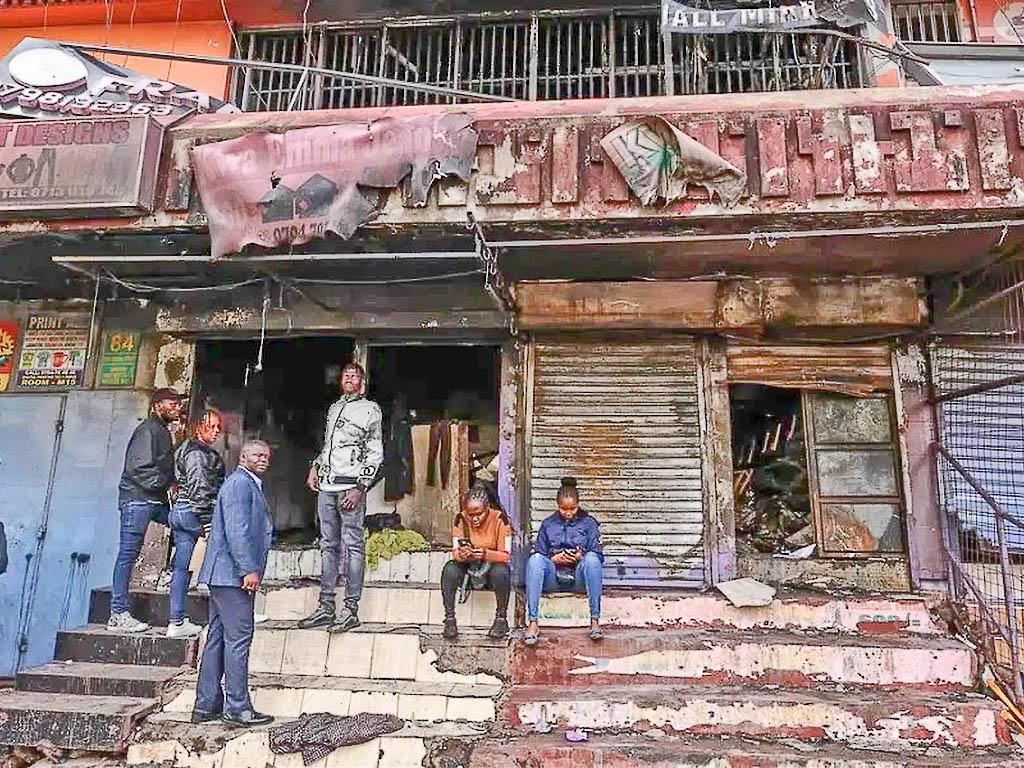

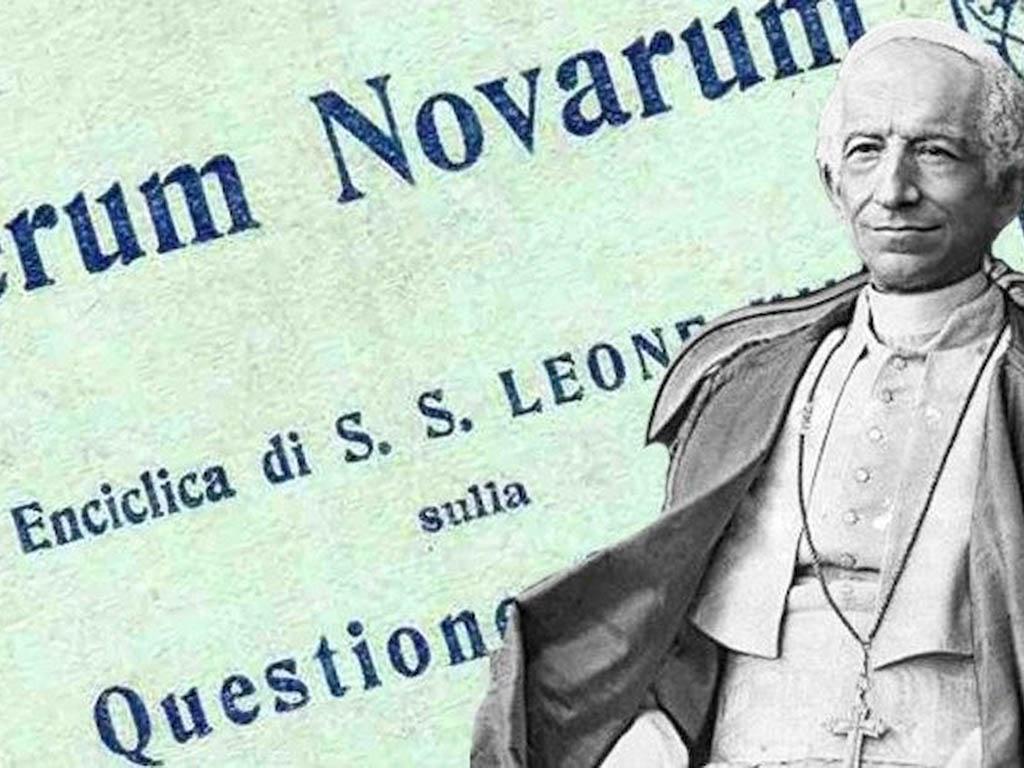



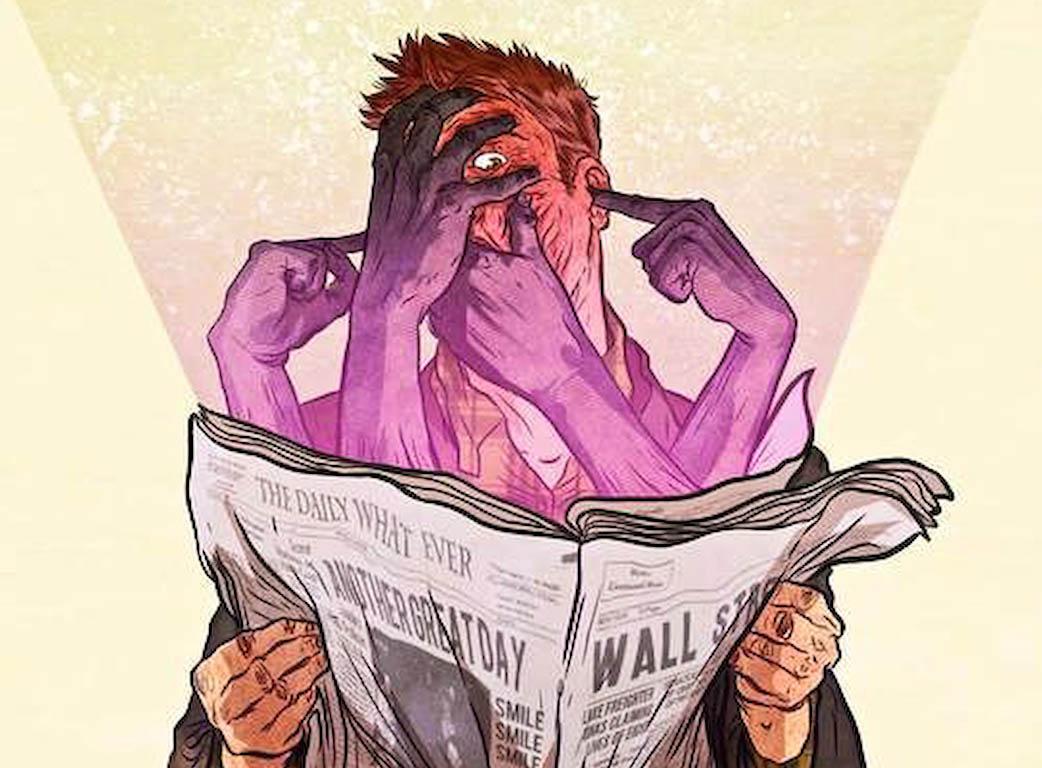







 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire