Un petit nombre d’entreprises contrôle la production agricole mondiale
Ginevra 17.10.2025 Corrispondente IPS Traduit par: Jpic-jp.orgLes machines destinées au semis des graines, ressource essentielle de l’agriculture moderne, sont dominées par quelques grandes compagnies. Cette situation, tout au long de la chaîne agricole, permet à un petit nombre de personnes de décider de ce qui est planté, de la manière dont cela se fait et, en fin de compte, de ce que les gens mangent, selon des experts en droits humains de l’ONU.

Un groupe de puissantes entreprises contrôle une grande partie de la production agricole mondiale, des marchés des intrants et des chaînes d’approvisionnement alimentaire, ce qui menace la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance ruraux, ont averti des experts en droits humains des Nations Unies.
Cette concentration du pouvoir « sape l’autonomie des petits agriculteurs, aggrave les inégalités et met en danger les fondements écologiques de nos systèmes alimentaires », ont déclaré les experts, qui agissent sous mandat du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, à Genève.
Les experts ont expliqué que « les paysans et petits producteurs nourrissent la majorité de la population mondiale avec des aliments sains et variés. Pourtant, ils sont de plus en plus marginalisés et dépossédés par l’expansion des systèmes alimentaires dominés par les entreprises ». « Le modèle agro-industriel actuel, soutenu par des États puissants, privilégie les profits économiques au détriment des personnes et de la planète. Cela doit changer », ont ajouté les experts dans leurs rapports à l’Assemblée générale de l’ONU.
Les rapporteurs sont le juriste canadien Michael Fakhri, rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, et le groupe de travail sur les paysans, présidé par le Colombien Carlos Duarte et composé de Geneviève Savigny (France), Shalmali Guttal (Inde), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) et Davit Hakobyan (Arménie).
Un rapport de Fakhri affirme que « la concentration du pouvoir des entreprises est telle qu’un groupe relativement restreint de personnes détermine quoi et comment cultiver, les conditions de travail, les prix et ce que l’on mange, dans le seul but de maximiser les bénéfices plutôt que d’agir pour le bien public ». « Beaucoup d’entreprises agroalimentaires transnationales s’emploient davantage à vendre des produits comestibles qu’à offrir de la vraie nourriture », ajoute Fakhri.
Les experts mettent en garde contre les pratiques d’entreprise qui ont engendré, dans l’ensemble, « de profondes dépendances qui érodent la résilience rurale et minent l’autonomie de ceux qui soutiennent nos systèmes alimentaires ». Parmi ces pratiques : l’acquisition massive de terres, la monopolisation des semences et des produits agrochimiques, la spéculation alimentaire, les formes abusives d’agriculture sous contrat et la mainmise sur les espaces décisionnels autrefois occupés par les paysans et les travailleurs ruraux.
Ils observent aussi que les technologies numériques transforment encore davantage les systèmes alimentaires, souvent en renforçant le contrôle des entreprises par l’appropriation des données agricoles. « Ces tendances, combinées à la crise climatique, ont encore aggravé la menace qui pèse sur le droit à l’alimentation de millions de personnes », affirment-ils.
Pour illustrer la concentration du pouvoir économique, les rapports fournissent des données sectorielles : dans le domaine des semences et des pesticides, quatre entreprises (les allemandes Bayer et Basf, l’américaine Corteva et la suisse Syngenta) contrôlent 56 % du marché mondial des semences commerciales et 61 % de celui des pesticides. Ces entreprises ont recours de plus en plus aux organismes génétiquement modifiés et à l’intelligence artificielle pour développer de nouvelles semences.
Dans le secteur des engrais, cinq entreprises — OCP (Maroc), Mosaic et Nutrien (États-Unis), ICL (Israël) et Sinofert (Chine) — contrôlent 25 % du marché du phosphate.
Concernant la machinerie agricole, quatre entreprises — Deere et Agco (États-Unis), Kubota (Japon) et CNH Industrial (Pays-Bas) — détiennent 43 % du marché mondial et investissent dans l’agriculture de précision pilotée par l’intelligence artificielle.
Dans le domaine des produits pharmaceutiques vétérinaires, les 10 principales entreprises contrôlent 68 % du marché, et les quatre premières (Zoetis, Merck, Elanco – États-Unis – et Boehringer, Allemagne) presque 50 %.
Enfin, dans la génétique avicole, trois entreprises — Tyson Foods (États-Unis), EW Group (Allemagne) et Hendrix Genetics (Pays-Bas) — dominent le secteur. Aux États-Unis, elles fournissent 98 % du matériel génétique pour les poulets ; la situation est similaire au Brésil, en Chine et en Afrique.
Pour les rapporteurs de l’ONU, le pouvoir des entreprises « devient un problème lorsque celles-ci peuvent accroître leurs profits en augmentant les prix (notamment des intrants) ou en réduisant les salaires ». Ils ajoutent : « Les entreprises contrôlent également les conditions matérielles — technologie, conditions de travail, procédés de transformation, environnement alimentaire — de sorte que les consommateurs voient leurs choix se restreindre ».
Face à cela, « les États ont l’obligation de réglementer les activités des entreprises, de prévenir les abus et les violations des droits humains, et de garantir l’accès à la justice pour les victimes », soulignent-ils.
Enfin, ils appellent tous les gouvernements, le secteur privé et les organismes de l’ONU à placer les petits agriculteurs, pêcheurs, éleveurs et travailleurs ruraux au cœur des politiques alimentaires.
Voir, Un puñado de empresas controla la producción agrícola mundial
Imagen © John Deere





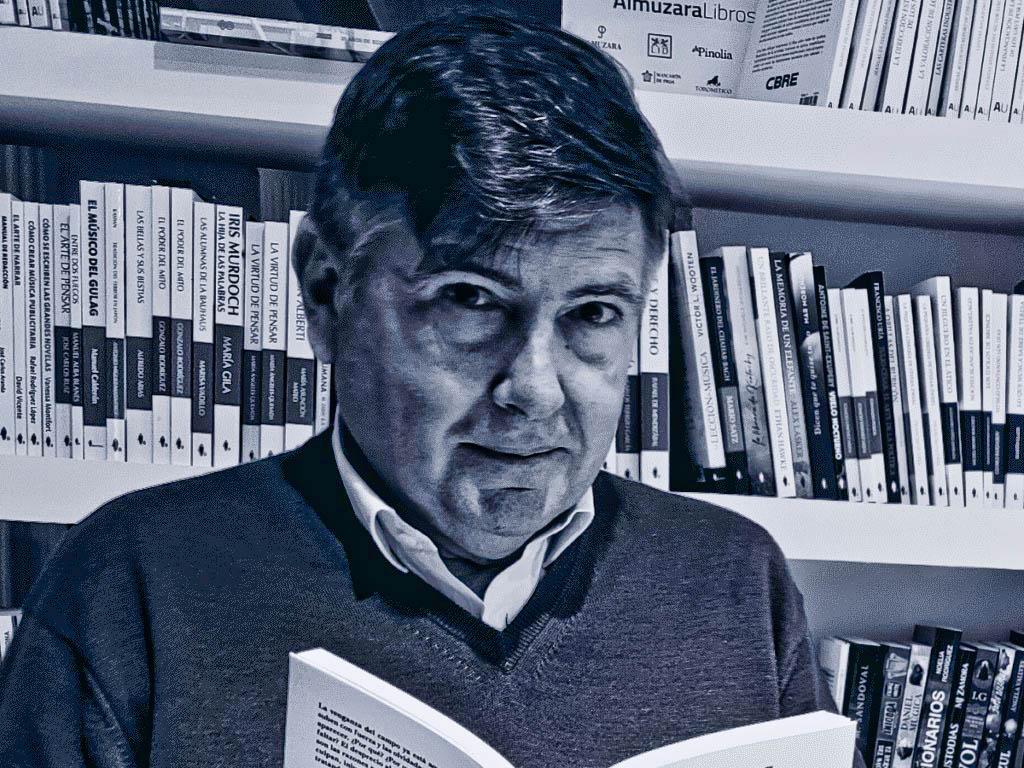















 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire