Face aux défis que nous devons affronter
Butembo 20.09.2025 Jpic-jp.org Traduit par: Jpic-jp.orgManifestations, flottilles, affiches, grèves pour réclamer les droits des Palestiniens, des agriculteurs, de l’Ukraine, et la liste serait longue si l’on voulait la rendre complète. De toutes parts s’élèvent des voix contre les injustices commises dans le monde, les guerres, les catastrophes environnementales que l’on constate, mais…

Peu de personnes se reconnaissent responsables de deux péchés d’omission de l’histoire récente : l’éducation au bien commun et à la fraternité, fondamentales pour une société juste et solidaire ; la responsabilité de ne pas savoir prévoir les conséquences futures des actions présentes.
Bien commun et fraternité
Comme le dit un proverbe africain : « Quand chacun ne pense qu’à sa cruche, le village meurt de soif ». Éduquer au bien commun et à la fraternité représente un principe fondamental pour la construction d’une société juste et solidaire. Alcide De Gasperi, homme d’État italien et l’un des pères fondateurs de l’Europe communautaire, fit de cet idéal sa vie. Sa vision politique et son action furent toujours orientées vers la promotion de la paix et de la solidarité entre les nations. De Gasperi croyait fermement que seule l’union des peuples européens, au-delà des divisions et des rivalités historiques, permettrait de garantir un avenir de stabilité, de prospérité et de justice pour les générations futures.
L’homme d’État, après la Seconde Guerre mondiale, fut l’un des protagonistes du processus de reconstruction de l’Italie et de l’Europe. Conscient des tragédies qui avaient marqué le conflit, il travailla sans relâche pour promouvoir une vision de l’Europe fondée sur le dialogue et la collaboration, sans condition.
Son engagement fut déterminant pour la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier en 1951, l’un des premiers pas vers l’intégration européenne. La CECA visait à mettre sous contrôle commun les ressources stratégiques de l’industrie, garantissant qu’aucun pays européen ne puisse plus utiliser ces ressources à des fins de guerre, mais uniquement pour la croissance et le bien-être collectif.
La base de son approche était la fraternité entre les peuples, dans la conscience que solidarité et coopération étaient les clés pour surmonter les conflits et construire un avenir de paix. Il voyait l’Europe comme une « communauté de destin », où chaque nation devait contribuer au bien commun, en mettant de côté ses intérêts particuliers et ses privilèges nationaux pour favoriser le progrès collectif.
Ce concept d’union solidaire se reflète dans les principes fondateurs de l’Union européenne qui, malgré les difficultés et les défis, devrait continuer à promouvoir une coopération fondée sur des valeurs partagées de paix, de démocratie et de respect mutuel.
L’exemple de De Gasperi, aujourd’hui plus que jamais, est d’une grande actualité : l’Europe fait face à de nouveaux défis mondiaux, tels que les droits de douane, la crise migratoire, les inégalités économiques et la polarisation politique croissante. Éduquer au bien commun et à la fraternité signifie travailler sans cesse pour une coexistence pacifique et prospère entre différentes cultures et nations, en valorisant les diversités et en construisant ensemble un avenir meilleur, sans hésitation, en mettant en avant le principe de fraternité dans toute son ampleur.
Malheureusement, on peut douter que beaucoup d’hommes politiques aient aujourd’hui une vision du bien commun digne de véritables hommes d’État.
Prévoir les conséquences des actions présentes
Comme le dit un autre proverbe africain : « Celui qui abat l’arbre de l’ombre n’aura demain ni où se reposer, ni où s’asseoir avec son voisin ». Savoir penser l’avenir est essentiel pour prévoir les conséquences du présent sur les générations futures et sur le développement des relations entre les peuples.
Face aux accusations que des pays, des organismes et l’opinion publique lui adressent pour les massacres à Gaza, Netanyahu parle « d’hypocrisie », « d’hypocrisie politique ». L’hypocrisie est l’attitude de celui qui déclare des valeurs, des principes, des sentiments ou des intentions qu’il ne possède pas ou qu’il ne suit pas. L’hypocrisie politique, c’est ce comportement dans la vie publique et le pouvoir : proclamer des idéaux de justice, de paix ou de démocratie, mais poursuivre en réalité des intérêts personnels ou partisans ; promettre des réformes, défendre publiquement certaines valeurs morales ou religieuses, déclarer agir « pour le bien du peuple », alors qu’en réalité on recherche le pouvoir ou les privilèges d’une minorité. L’hypocrisie politique est l’écart entre le discours public et la réalité des actions.
Ce que Netanyahu entend exactement par cette accusation « d’hypocrisie » est difficile à savoir ; une hypocrisie historique manifeste peut toutefois être constatée. Si l’accusation de génocide est discutable, la volonté de faire de la Palestine le seul État d’Israël, avec pour conséquence l’exode global des Palestiniens, est en revanche évidente.
Mais déjà au Moyen Âge, des courants juifs priaient et espéraient un retour à Sion ; le sionisme, en tant que mouvement politique et culturel, naît à la fin du XIXᵉ siècle, dans un contexte de nationalismes et d’antisémitisme croissant. La date symbolique de sa naissance est 1897, lorsque Theodor Herzl organisa à Bâle (Suisse) le Premier Congrès sioniste.
Et quel était l’objectif du sionisme ? Depuis toujours : reconstruire l’identité juive en fondant une patrie pour les Juifs en Palestine. La Palestine était alors sous l’Empire ottoman. La Turquie, héritière de l’Empire ottoman, favorisa ce projet en vendant aux Juifs des terres occupées par les Palestiniens.
Plus tard, l’Angleterre, qui obtint le mandat sur la Palestine, et les pays arabes ne se préoccupèrent pas outre mesure du sionisme, que l’antisémitisme grandissant renforça et que la Shoah confirma comme projet politique précis : l’État d’Israël.
L’étude Une « question juive » italienne sur le front oriental 1941-43 - Una "questione ebraica" italiana al fronte orientale 1941-43 - montre que ce fut seulement le rôle prépondérant joué par les Allemands dans la Shoah qui amena, par exemple, « à négliger celui des alliés italiens », et qu’en Ukraine, alors partie de l’Union soviétique, « environ 1,5 million de Juifs furent physiquement éliminés ».
Quand en 1947 l’Assemblée générale de l’ONU approuva la Résolution 181, qui prévoyait la partition de la Palestine en deux États, l’un juif et l’autre arabe, avec Jérusalem sous régime international, la majorité des pays arabes s’y opposa, refusant un État juif.
Et après la proclamation d’Israël (14 mai 1948), les armées d’Égypte, de Transjordanie (Jordanie), de Syrie, du Liban et d’Irak, soutenues par des contingents et des volontaires d’autres pays arabes, entrèrent en guerre contre le nouvel État. Ce conflit, connu comme la Première guerre israélo-arabe ou guerre de 1948, avait pour objectif déclaré d’empêcher la naissance et la consolidation d’Israël.
Le résultat fut au contraire la victoire israélienne et l’élargissement du territoire par rapport à ce que prévoyait le plan de l’ONU. Depuis lors, les guerres des pays arabes, les menaces de l’Iran, du Hamas et du Hezbollah ont enfermé le conflit « Israël-Palestine » dans une impasse diplomatique, le condamnant à la seule solution de la violence.
Comme le dit un proverbe africain : « Si tu as perdu le chemin, tu ne le corrigeras pas en courant en avant, mais en revenant au point d’un bon départ ». C’était peut-être ce que certains pays arabes cherchaient à promouvoir en acceptant les Accords d’Abraham, que le Hamas et l’Iran voulurent détruire avec l’attaque du 7 octobre.
Quel espace reste-t-il alors pour le dialogue et la paix ? Peut-être l’intuition, reprise avec force par le pape François, que tout est interrelié parce que tout a une base et une origine commune, soulève la question : le changement climatique, la guerre d’Israël à Gaza et tant d’autres problèmes de notre société actuelle n’ont-ils pas leurs racines dans le fait que le « bien commun » des peuples n’est pas le fondement des sociétés, afin qu’elles soient justes et solidaires ? L’incapacité à prévoir les conséquences futures de certaines décisions n’est-elle pas à l’origine de tant de malheurs actuels ?
Celui qui oublie le bien commun sème déserts et guerres et, sans regard vers l’avenir, les actions d’aujourd’hui deviennent les désastres de demain. La terre blessée et les peuples en guerre ont la même racine : l’égoïsme aveugle des individus et des peuples. Si l’on ne recherche pas le bien commun, on attise à la fois les flammes de la guerre et celles du climat.
Comme le disent les proverbes africains : « Celui qui allume le feu pour brûler celle de son ennemi oublie que le vent peut aussi brûler sa propre hutte ». « Celui qui ne prend pas soin de la terre et de la paix laisse à ses enfants poussière et larmes. »
Voir aussi, Le nuove sfide globali che deve affrontare l’Europa











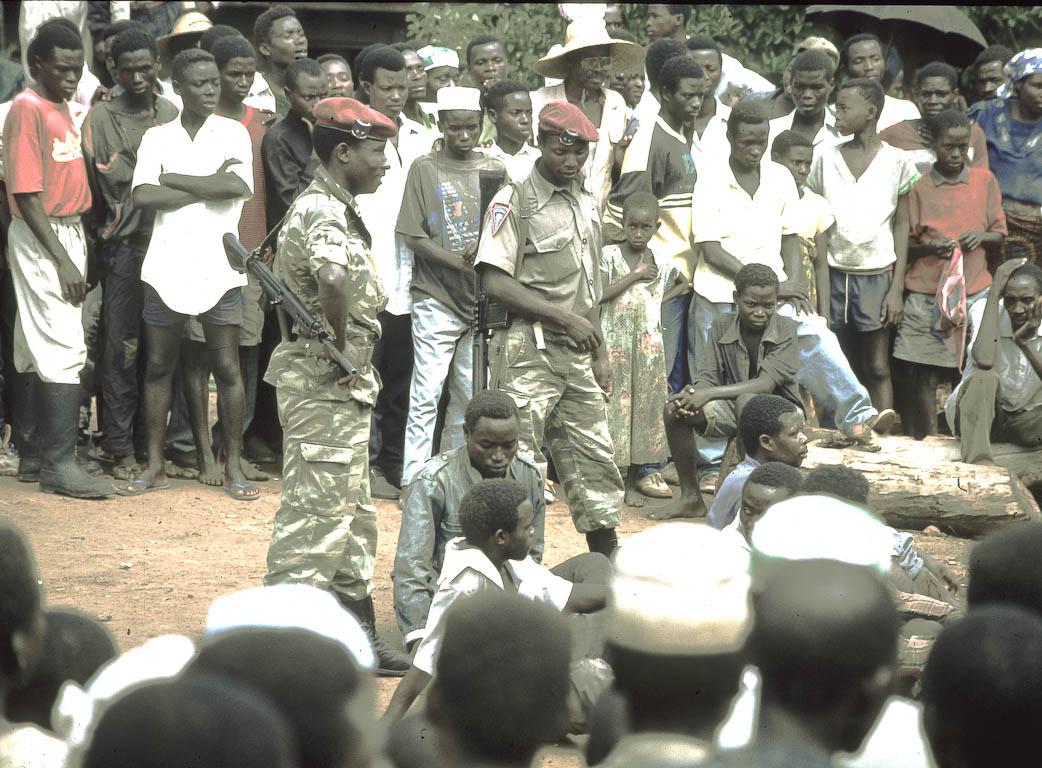









 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire