Namibie, le génocide oublié
Rivista Africa 02.10.2025 Annaflavia Merluzzi Traduit par: Jpic-jp.orgLe 2 octobre 1904 marquait le début du génocide colonial allemand contre les communautés herero et nama en Namibie. Plus d’un siècle après, les blessures restent ouvertes : aucune réparation concrète, une mémoire officielle contestée et des négociations qui ont échoué. Les deux communautés descendent dans la rue pour revendiquer vérité, terre et justice.

Le 2 octobre 1904, le général allemand Lothar von Trotha, commandant responsable de l’administration militaire dans les territoires coloniaux de la Namibie, ordonna l’extermination des communautés herero et nama. Cet ordre marqua le début du génocide des populations autochtones, qui ne s’acheva qu’en 1908, et ouvrit pour l’Allemagne la voie aux expérimentations sur les tueries de masse qui mèneraient plus tard à l’Holocauste.
En l’espace de ces quatre années, on estime qu’environ 80 % des Herero et 50 % des Nama furent tués, aussi bien directement que par l’épuisement causé par les travaux forcés dans les camps de concentration, l’exploitation sexuelle et les expérimentations médicales. La faim et les maladies, aggravées par l’état d’indigence dans lequel ils vivaient, la confiscation du bétail et la déportation dans les zones désertiques du Kalahari achevèrent d’anéantir leurs communautés.
Aujourd’hui encore, les deux communautés n’ont reçu aucune réparation pour les torts subis, restent confinées dans une condition de marginalité sociale et leurs appels demeurent sans réponse. Elles revendiquent désormais le 2 octobre comme journée nationale.
L’instauration d’une journée de la mémoire a donc un goût amer, car elle est perçue comme purement symbolique, détachée des événements historiques qui ont tracé les lignes du massacre. Cette année, en effet, la présidente de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a célébré pour la première fois le 28 mai comme journée de la mémoire du génocide, un an après sa proclamation. C’est la date à laquelle, en 1907, les camps de concentration furent fermés. Dans son discours, Nandi-Ndaitwah déclara :
« Ces actes terribles font désormais partie de notre histoire collective de résistance et de résilience dans notre marche vers la liberté », ajoutant : « Notre présence à cette occasion marque une étape décisive dans l’élaboration du passé, à travers le souvenir collectif et le partage de la douleur des communautés herero et nama ».
Selon Nandi Mazeingo, président de la Ovaherero Genocide Foundation, « c’est une manière de travestir la véritable histoire des luttes anticoloniales courageusement menées par les Herero et les Nama, d’effacer leur engagement dans la défense de leurs terres et de leur bétail, quand personne d’autre n’osait le faire ».
L’ordre d’extermination du 2 octobre faisait en effet suite à la répression des mouvements de libération menés par les deux communautés, dans le but de les briser et d’empêcher toute nouvelle insurrection. Pour cette raison, ne reconnaissant pas le 28 mai, les représentants herero et nama ont organisé une célébration indépendante, commencée le 1er et achevée le 2 octobre, centrée sur la mémoire historique de l’événement.
« Nous choisissons le 2 octobre pour commémorer le massacre, même si ce souvenir nous poursuit chaque jour, car nous continuons à vivre sans terre, sans bétail, dans l’exil, la pauvreté et la marginalisation », explique Mazeingo.
La fondation a organisé un rassemblement de masse qui, partant d’Okahandja, marchera jusqu’à la capitale Windhoek en traversant les lieux symboliques du génocide. Parades, exercices militaires et cérémonies passeront devant l’église luthérienne, considérée comme un « acteur clé dans la réalisation du génocide », où une pétition sera remise au pasteur. Le même geste sera répété à l’ambassade d’Allemagne à Windhoek. La journée se conclura devant le Parlement namibien, accusé de complicité dans les retards des réparations et jugé incapable de représenter les Ovaherero et les Nama.
« Nous passerons aussi devant le musée de l’indépendance et les écoles, pour éduquer notre pays et le monde à notre histoire, encore aujourd’hui exclue des programmes scolaires et du récit public. Là, notre chef suprême, Mutjinde Ktjiua, prononcera un discours devant les médias », ajoute Mazeingo.
Les tensions internes font suite à des années de négociations entre le gouvernement namibien et le gouvernement allemand, dont les Herero et les Nama se sont toujours plaints d’avoir été exclus. En 2021, après huit années de médiation diplomatique, Berlin proposa un accord de 1,1 milliard d’euros à verser sur trente ans, sous forme de financements pour les infrastructures, la formation professionnelle, l’approvisionnement en eau et des projets de réforme foncière.
Mais dans le projet d’accord, il n’était nullement question de réparations, et aucun représentant des deux communautés n’avait été impliqué dans sa rédaction. Les protestations, menées par les descendants des victimes, ont provoqué un blocage de la signature et abouti à une plainte, toujours en cours, déposée devant la Haute Cour du pays contre le gouvernement. Les accusations portaient sur la violation d’une résolution du Parlement namibien de 2006, qui prévoyait que les descendants des victimes siègent directement à la table des négociations avec Berlin et qu’eux – et non l’État – bénéficient des compensations.
L’héritage postcolonial du pays, un peu comme celui de l’Afrique du Sud après l’apartheid et du néocolonialisme en général, voit encore la minorité blanche détenir la majorité des terres : environ 5 % de la population, dont 1 % germanophone, possède 70 % des terres agricoles.
Du point de vue des Herero et des Nama, Berlin devrait racheter les terres appartenant aux propriétaires germanophones et les restituer aux deux communautés, pour réparer réellement les expropriations subies pendant la domination coloniale.
L’inaction du gouvernement sur cette question et le boycott de la date du 2 octobre demandée par les Herero et les Nama pour la journée de la mémoire démontrent, selon Mazeingo, « la collaboration de la Namibie avec l’Allemagne néocoloniale ».
Les commémorations ont voulu ramener à l’attention publique l’échec des négociations et pousser vers une mise en œuvre conforme à la résolution parlementaire de 2006, car, conclut Mazeingo : « Toute organisation sponsorisée par des entités extérieures à nous n’est pas la nôtre, n’est pas pour nous, et nous n’y prendrons donc pas part ».










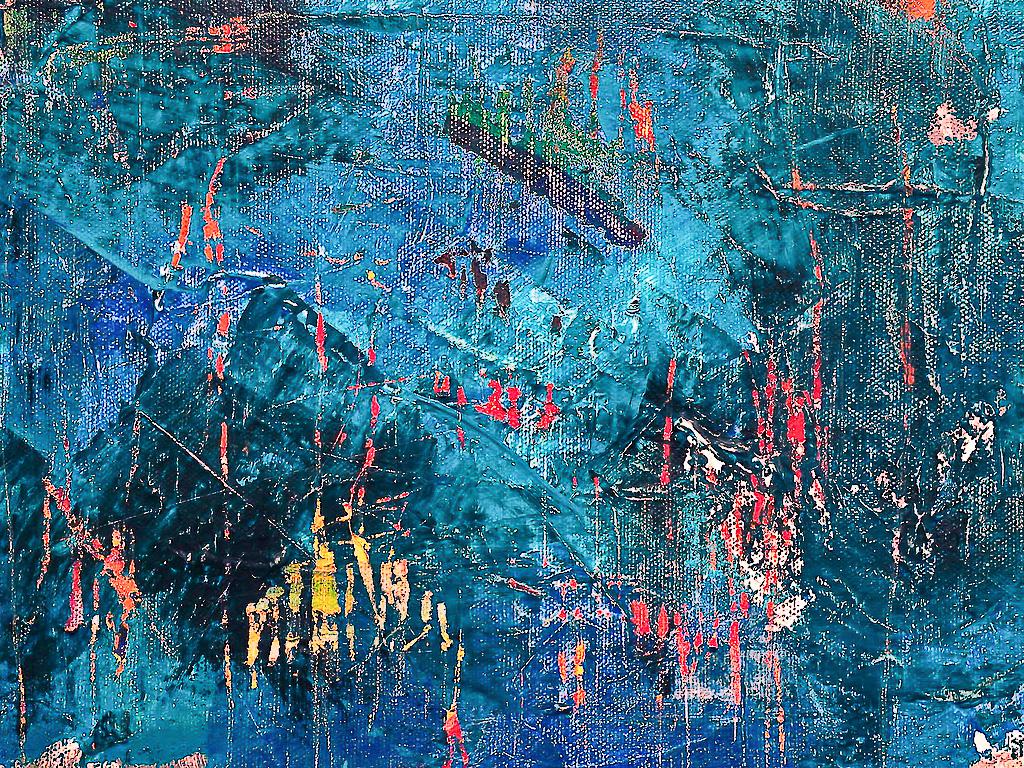


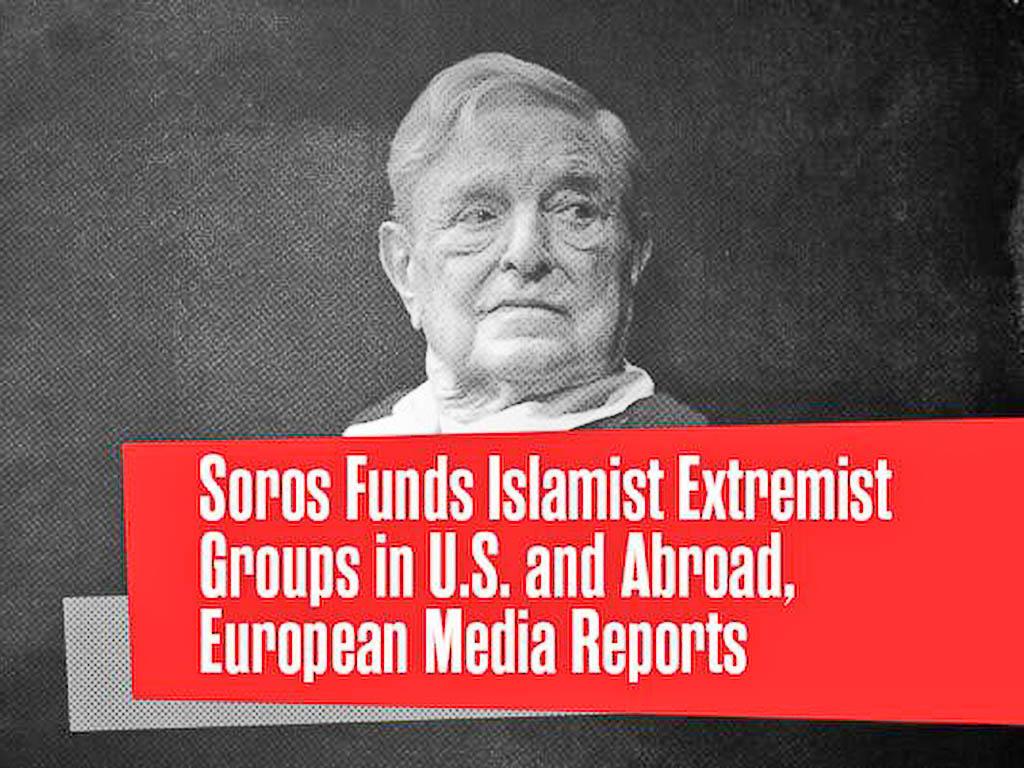







 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire