La chimère de la coexistence sur une terre divisée par l’histoire
Repubblica.It 29.11.2025 Lucio Caracciolo Traduit par: Jpic-jp.orgEn 1977, l’Assemblée générale de l’ONU déclara le 29 novembre « Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien ». Cette date fut choisie parce que le 29 novembre 1947 avait été adoptée la résolution 181 prévoyant le « Plan de partage de la Palestine ». Le 29 novembre 2012, l’ONU accorda à l’État de Palestine le statut d’observateur permanent. Voici une analyse de Lucio Caracciolo, publiée le 6 décembre 2012. Après le 7 octobre, les données ont changé, mais la réalité géopolitique reste essentiellement la même.

Quelle différence y a-t-il entre le Saint-Siège et la Palestine ? Selon l’ONU, aucune, depuis que le 29 novembre dernier l’Assemblée générale a élevé, à une majorité écrasante (138 voix pour, 9 contre et 41 abstentions), l’Autorité nationale palestinienne (ANP) au rang d’« État observateur non membre », le même statut que celui dont jouit l’entité vaticane. Mais tandis que la monarchie papale, avec ses 572 citoyens sur 0,44 kilomètre carré, est un État à part entière, l’ANP du « maire de Ramallah », Abou Mazen, demeure une catégorie de l’esprit.
Elle ne contrôle aucun territoire souverain : ce qu’il reste de la Cisjordanie occupée par Israël, amputée par le Mur et colonisée par les implantations juives – parmi lesquelles de véritables villes fortifiées – est étroitement surveillée par les forces armées de Jérusalem. Ainsi, aujourd’hui, dans la « Palestine historique », à côté de l’État d’Israël, nous trouvons deux fragments isolés – Gaza et des portions de la Cisjordanie – qui échappent à toute définition géopolitique.
Dans le premier, vaste comme l’ancienne province de Prato (Italie), sont comprimées plus d’un million et demi d’âmes, sous le régime islamiste du Hamas. Dans le second, plus petit que la province de Pérouse (Italie), s’entassent deux millions et demi de Palestiniens, auxquels s’ajoutent près d’un demi-million de colons juifs.
Sur ce fond, le refrain « deux peuples, deux États » que la « communauté internationale » – autre entité indéfinissable – continue obstinément de psalmodier, sonne plutôt comme une moquerie. Ce n’est certainement pas le vote du Palais de Verre qui le rendra moins abstrait. Et pourtant, autour de ce slogan s’est animé un nouveau théâtre rhétorico-diplomatique que les protagonistes du conflit israélo-palestinien éprouvent le besoin de mettre en scène à intervalles irréguliers pour certifier que le contentieux est toujours en vie. Et donc leur droit de s’en occuper, en professionnels de la négociation virtuelle.
La dramatisation scénique ne doit pas nous faire perdre de vue l’essentiel : le rêve (ou le cauchemar) des deux États reste une chimère. Pour de nombreuses raisons, dont deux décisives : le peuple palestinien est loin de former une nation ; en même temps, l’hétérogénéité croissante de la population israélienne pousse Jérusalem à cimenter le front intérieur dans une logique d’urgence permanente, garantissant le statu quo géopolitique et donc son titre de première puissance régionale.
Considérons les Palestiniens. Ils sont aujourd’hui environ 12,5 millions. Parmi eux, quatre millions vivent dans les Territoires occupés (Gaza et Cisjordanie), qui pour Israël sont des « territoires disputés ». Soit seulement un tiers du total. Le reste (4,5 millions) est constitué de réfugiés dans les pays arabes, souvent entassés dans des camps invivables, traités comme des parias par des régimes qui se proclament pourtant défenseurs de leur cause ; d’autres (1,2 million) sont citoyens de Jordanie, confinés dans la maison délabrée du roi hachémite ; autant encore sont dispersés dans le monde, surtout en Europe et en Amérique du Nord.
Enfin, près d’un million et demi sont israéliens. Citoyens non sionistes de ce que certains d’entre eux continuent à considérer comme une « entité sioniste », ils sont traités comme des sujets de seconde zone par le gouvernement de Jérusalem et comme des traîtres par les plus fanatiques de leurs compatriotes (non concitoyens). Toutefois, ils répugnent à échanger le bien-être et les garanties relatives de la démocratie israélienne contre la cage de Gaza ou la Cisjordanie occupée et déprimée.
Par ailleurs, des hiérarchies claniques ancestrales prévalent parmi les Palestiniens. Certaines se reflètent dans la fragmentation politique, polarisée entre les « modérés » (parce qu’acceptés par l’Occident) du Fatah et les « extrémistes » (classés comme « terroristes » par Israël) du Hamas, outre un chapelet de formations mineures, des plus laïques et libérales à celles d’inspiration islamiste proches de l’Iran.
Chacune de ces organisations dispose de sa milice et de ses services de renseignement, presque toujours plus d’un. Plutôt que de se consacrer à combattre l’ennemi sioniste, et collaborant souvent avec le Mossad, ces bandes se disputent les trafics de toutes sortes qui prolifèrent à l’ombre de l’occupation israélienne. En somme, le peuple palestinien souffre, et survit grâce à l’aide internationale (qui contribue à le dénationaliser), mais est loin de former une nation compacte et résolue à revendiquer son propre État.
Israël, de son côté, fait tout pour empêcher que les différentes âmes palestiniennes se rassemblent en un front unique. Avec le résultat paradoxal de mieux s’entendre avec le Hamas – aujourd’hui le « moindre mal » dans la bande de Gaza, infiltrée par des groupes qaïdistes et des milices pro-iraniennes – notamment grâce à la médiation de la nouvelle Égypte de Morsi, plutôt qu’avec le clan de Ramallah, de toute façon facilement soumis au chantage en raison de son hyper corruption.
Qu’on ne se laisse pas tromper par les « guerres de maintenance » Hamas-Israël, qui servent à huiler les mécanismes d’un blocage auquel aucune des deux parties n’entend renoncer, faute de meilleures alternatives.
Quant au peuple israélien, les citoyens de l’État d’Israël sont environ huit millions, dont près de six classés comme juifs, 1,7 million arabes et 0,3 million d’autres origines. Selon les statistiques officielles, un quart des habitants de l’État juif ne sont donc pas juifs. Et de temps à autre résonne l’alarme du dépassement arabe dans l’espace de l’ancien mandat britannique, entre Méditerranée et Jourdain, récemment relancée par Ha’aretz sur la base de statistiques discutables fondées sur le fisc.
Mais le problème majeur, pour la judéité de l’État juif, ne provient pas tant de la croissance arabe à ses frontières floues (c’est-à-dire dans les limites du « Grand Israël », étendu à la "Judée-Samarie"/Cisjordanie que des divisions internes à la majorité juive. Non seulement la partition classique entre séfarades et ashkénazes, mais aussi celles récemment accentuées par l’immigration de nouveaux Israéliens d’ascendance africaine et surtout slave.
Des immigrés récents qui constituent, entre autres, le gros de l’armée nationale. À commencer par les juifs d’origine russe, dont certains seraient mieux définis comme des Russes d’origine juive (parfois revendiquée), qui occupent des positions de premier plan dans l’élite politique et dans les hiérarchies sociales d’Israël, souvent dotés d’un double ou triple passeport.
Sans parler de l’incommunicabilité entre les extrémistes ultra-religieux, concentrés entre Jérusalem et les colonies, et les juifs bien plus laïcs, majoritaires à Tel-Aviv et dans ses environs.
Autrefois, quand le vendredi les prêtres avaient envie de viande, ils l’appelaient poisson. L’« ego te baptizo Palestinam » prononcé par l’Assemblée générale de l’ONU peut amuser les cyniques, mais ne change pas les termes du drame. La Palestine est ailleurs.
Voir, La chimera della convivenza in una terra divisa dalla storia











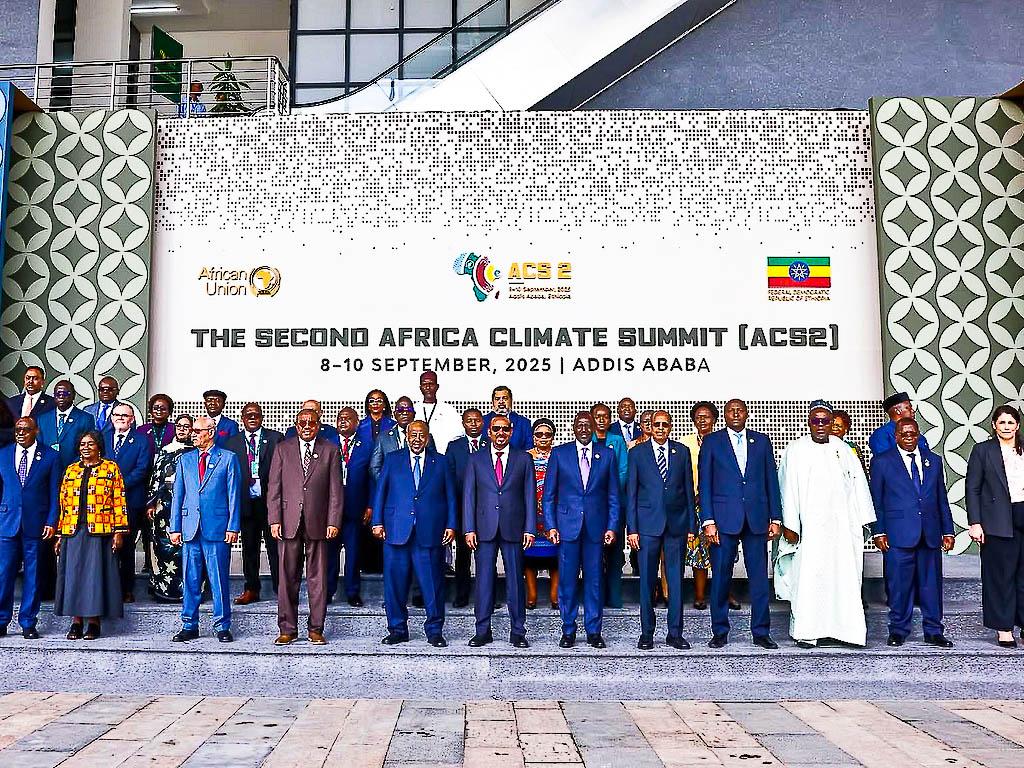









 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire